

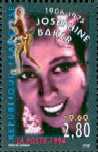
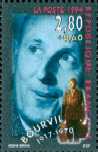
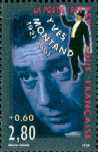

Printemps
Baker
Montand
|
Célébrités 1994 : de la scène à l'écran.
|
|||||
 |
 |
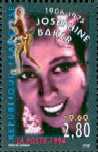 |
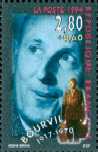 |
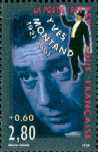 |
 |
|
Yvonne Printemps |
Fernandel |
Joséphine Baker |
Bourvil |
Yves Montand |
Coluche |
|
|
|||||
| Yvonne Printemps (1894-1977) | |||
       
|
|||
|
Elle ne chante pas, elle se contente de respirer mélodieusement disait Colette d'Yvonne Printemps. Particulièrement douée pour le chant et la danse, Yvonne Wigniolle (son nom de famille) commença très jeune sur les planches. Née en 1894, elle débuta à l'âge de 14 ans à La Cigale, puis elle participe à la revue des Folies Bergères en même temps que Maurice Chevalier. Sacha Guitry lui offrit le rôle de Melle Certain dans Jean de La Fontaine en 1917. Il l'épouse en 1919, ayant eu pour témoins Sarah Bernard et Georges Feydeau. Son mari écrivit pour elle de nombreuses opérettes, comédies et revues, en tout 34 pièces en vers et en prose. Ses admirables yeux bleus pétillants de vie, sa voix de diva, firent la conquête du public parisien. Ses premiers pas au cinéma en 1918 dans un film muet Un roman d'amour et d'aventures furent sans lendemain. Sa seconde chance à l'écran, elle va la saisir avec Pierre Fresnay. Ils tournent ensemble : La Dame aux camélias (1934), Adrienne Lecouvreur et Trois Valses (1938), Le Duel (1939), Je suis avec toi (1943), Les Condamnés (1947), La Valse de Paris (1949), Le voyage en Amérique (1951). Si toutes ses apparitions à l'écran furent un succès, Yvonne Printemps fit surtout une carrière théâtrale. Sur scène, notamment celle du théâtre de la Michodière qu'elle dirige à partir de 1942, la diva triomphe. Elle y jouera, auprès de Pierre Fresnay, Léocadia d'Anouilh (1940), Comédie en trois actes de Clouzot (1941), Père de Bourdet et, du même auteur, Vient de paraître (1945) et Hyménée (1952). En 1959, Yvonne Printemps quitte définitivement les planches, tout en conservant la direction du théâtre de la Michodière jusqu'à sa mort en 1977. |
|||
|
| Fernandel (1903-1971) | |||
       
|
|||
|
Sa popularité était à la mesure de son sourire : immense. Cette denture impressionnante et son accent non moins impressionnant ont fait de Fernandel l'une des "gueules" les plus singulières du cinéma français. De son vrai nom, il s'appelait Fernand Constantin et naquit en 1903, à Marseille. Son père était employé de bureau et chanteur de café-concert pendant ses loisirs. Le fils suivra très tôt la même voie. Subjugué par Polin, un comique troupier en vogue avant-guerre, il imite son idole les samedis et dimanches dans les noces et les caf'conc'; tout en exerçant divers métiers dans la semaine. Un directeur de tournée le remarque et le fait passer à Bobino, à Paris : à 25 ans, il se fait déjà un nom dans la capitale. Le jeune comique, qui joue Fibremol fait des fredaines au concert Mayol, débute à l'écran en 1930, sur recommandation de Sacha Guitry, dans Le Blanc et le Noir, de Marc Allégret. Mais c'est en 1934 qu'il prend sa vraie dimension, dans Angèle de Marcel Pagnol, son premier rôle dramatique. Avec Regain (1937), Le Schpountz (1938) puis La Fille du puisatier (1940), Pagnol révèle définitivement Fernandel : "C'est à lui que je dois d'avoir pu prouver que j'étais un vrai comédien", reconnaîtra-t-il plus tard. Naïf ou malin, exubérant ou pudique, émouvant ou désopilant, il a joué tous les rôles. Impossible de citer les quelque cent cinquante films qui ont ponctué sa prolifique carrière. Tous ne méritent pas, du reste, de passer à la postérité. Dans cette collection de succès populaires, citons La Vache et le Prisonnier, d'Henri Verneuil (1959) ; Crésus (1960), écrit et tourné en Haute-Provence par Jean Giono ; La Cuisine au beurre (1963) où Fernandel tente de convertir à l'huile d'olive l'aubergiste Bourvil ; L'Age ingrat (1964), avec Jean Gabin et son fils Franck Fernandel ; Freddy (1966), un retour au théâtre avec une comédie policière. Sans oublier la série des Dom Camillo, dont le triomphe dépassa largement les limites de l'Hexagone. C'est en prenant une dernière fois la soutane pour tourner un cinquième Dom Camillo, en 1970, que Fernandel est frappé par la maladie. Il meurt peu après, à l'âge de 67 ans. |
|||
|
| Joséphine Baker (1906-1975) | |||
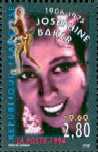 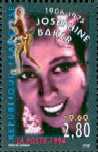 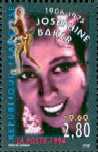 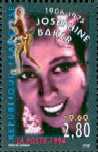 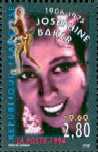 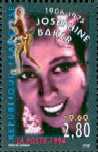 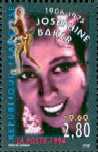 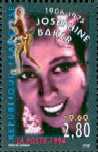
|
|||
|
"Alors entre en scène un personnage étrange... qui marche les genoux pliés, vêtu d'un caleçon en guenilles et qui tient du kangourou boxeur et du coureur cycliste". Ainsi le journal Candide décrit-il, en octobre 1925, la révélation de la dernière "Revue nègre". Joséphine Baker a presque 20 ans : elle est née en 1906, à Saint Louis, aux Etats Unis. Elle vient d'arriver à Paris, avec la compagnie "Black Birds". Le public du théâtre des Champs-Élysées découvre, médusé, cette splendide fille presque nue, qui chante d'une voix suave et danse sur un rythme stupéfiant. D'aucuns crient au scandale et à la lubricité, mais tout Paris se bouscule. La silhouette sculpturale de Joséphine Baker restera à jamais attachée aux années folles, période où les français oublient la Grande Guerre en se jetant dans l'insouciance et la création. Paris est alors le centre de toutes les audaces culturelles, et Montparnasse le quartier où tout se passe. Cocteau et Aragon tiennent salon au Jockey. Picasso discute littérature avec Henry Miller. Les "jazz bands" se déchaînent dans les cabarets. Coco Chanel habille les femmes de bleu marine et de blanc - "comme les écoliers", s'indignent les tenants du bon goût. Et Joséphine Baker promène sa panthère en laisse à la terrasse des cafés... Artiste de music-hall, elle s'est aussi consacrée au cinéma. A l'époque du muet, d'abord, dans deux films tournés en 1927 par Mario Nalpas : La Revue des revues et La Sirène des Tropiques. Puis, après l'arrivée du parlant, dans Zou-Zou de Marc Allégret, avec Gabin (1934) ; Princesse Tam-Tam (1935) et Fausse alerte (1939), où elle tient un rôle de second plan. Sa carrière à l'écran, exclusivement française, s'est arrêtée là. Sans doute le cinéma n'a-t-il pas su lui proposer des rôles sortant de l'exotisme facile où la cantonnait sa peau noire. Joséphine Baker a consacré la fin de sa vie aux nombreux enfants qu'elle avait adoptés et au milieu desquels elle vivait dans son château des Milandes, en Périgord. Près de vingt ans après sa mort, en 1975, sa plus célèbre chanson, qui fit les grandes heures du casino de Paris, est encore sur beaucoup de lèvres : "J'ai deux amours, mon pays et Paris"... |
|||
|
| Bourvil (1917-1970) | |||
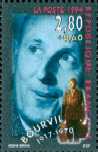 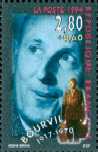 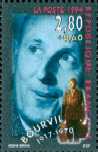 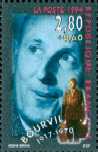 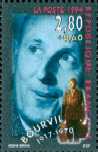 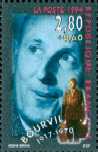 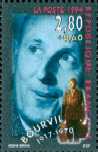 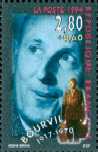
|
|||
|
Un itinéraire extraordinaire pour un homme ordinaire : ce fut là toute la vie d'André Raimbourg, plus connu sous le nom de Bourvil. Né en 1917 à Prétot-Vicquemare (Seine-Maritime), le jeune André Raimbourg, bon élève, doué pour les facéties, passa son enfance à Bourville. Peu séduit par le métier de cultivateur, il se fit apprenti boulanger avant de faire son service militaire dans le 24ème régiment d'Infanterie, à Paris, où il montrera ses talents de musicien. Là, il se produit de podium en podium, chante de petites chansons de son cru et remporte des prix. Démobilisé en 1940, il remonte à Paris et n'a qu'une pensée : devenir le "Fernandel normand". Il abandonne bientôt son modèle et se taille son propre costume de comique-paysan en se donnant une allure de benêt. La radiophonie fera du paysan cauchois une vedette. En effet, Bourvil savait parler au cœur des Français, un langage authentique. Sa simplicité, dont il ne s'est jamais départi, fut sans doute la raison de l'immense estime que lui portait son public. Pour tous, il fut un homme bon et généreux, à la scène comme à la ville. Plébiscité par la rue, Bourvil fait ses premiers pas au cinéma en 1945, dans un film de Jean Dréville, La Ferme du pendu. La Traversée de Paris de Claude Autant-Lara, réalisé en 1956, lui vaudra le prix de l'interprétation masculine au festival de Venise. Comédien instinctif, Bourvil a fait rire la France entière, notamment dans Le Corniaud (1964) et dans La Grande Vadrouille (1966) de Gérard Oury. Il a su aussi transmettre l'émotion dans des compositions un peu plus sérieuses. Au théâtre, il excellera dans des opérettes à succès telles que La Bonne Hôtesse (1946) ou La Route fleurie (1952). Par sa présence à l'écran ou au théâtre, Bourvil éclipsait bien involontairement ses partenaires. Quand André Raimbourg s'éteint en 1970, c'est la disparition d'un ami que les Français pleurent comme on pleure un cousin de province. Il est juste de lui rendre hommage aujourd'hui par l'émission d'un timbre-poste. |
|||
|
| Yves Montand (1921-1991) | |||
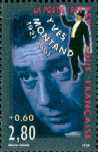 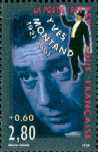 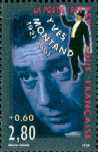 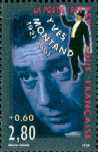 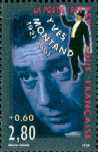 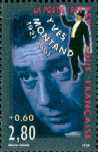 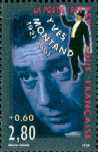 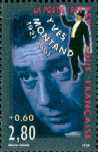
|
|||
|
Si, à sa disparition en 1991, Yves Montand a laissé l'image d'un artiste complet, ce fut au prix d'un travail acharné de tous les instants. Né en Italie en 1921, Yvo Livi était le fils d'émigrés antifascistes réfugiés à Marseille. Ses imitations de Trenet et de Fernandel et surtout son triomphe à l'Alcazar de Marseille lui vaudront une notoriété régionale. Pour échapper au STO, il "montera" à Paris où il rencontre Edith Piaf. Ce sera le tournant de sa carrière. Avec Edith, il tourne son premier film Étoile sans lumière (1945) puis viendra Les Portes de la nuit. Ce sera un échec, l'artiste ne parvenant pas à se départir d'une rigidité à l'écran. Quelques années passeront avant que Clouzot ne réussisse à révéler le talent de l'acteur dans Le Salaire de la peur. Car Montant était avant tout un comédien de la chanson à une époque où chanter demandait une gestuelle théâtrale. Le spectacle passait par sa voix mais aussi par ses yeux, ses mains, son corps : "Le compliqué de ce métier, disait-il, c'est qu'on doit, à chaque seconde, réinventer l'instinct". C'est grâce à La Guerre est finie et surtout à sa rencontre avec Costa-Gavras que Montand parvient à dissiper le malentendu qui subsistait entre lui et le cinéma. Après les tournées qui le mèneront des pays de l'Est (1957) à Broadway et Hollywood (1959-60), où Simone Signoret, sa femme depuis 1951, reçoit l'Oscar de la meilleure actrice, du Théâtre de l'Étoile à l'Olympia, il décide de se consacrer au cinéma. Il développera ainsi la palette de ses nombreux talents dans des films politiquement engagés (Z, 1968), (L'Aveu, 1970), des "policiers" (Police Python 357, 1976), des fantaisies (La Folie des grandeurs, 1972), des comédies douces amères (César et Rosalie, 1972). Revenu à la chanson en 1981, il sera le premier artiste de variétés au monde à se produire au Metropolitan Opera de New York en 1982. Viendront ensuite Jean de Florette et Manon des sources en 1986. "Le Papet" de Pagnol sera président du festival de Cannes en 1987, consécration d'une longue carrière cinématographique qui s'achèvera avec un dernier film, sorti en 1992, IP5 de Beineix. |
|||
|
| Coluche (1944-1986) | |||
       
|
|||
|
Un timbre sur Coluche : il aurait sans doute été le premier à en rire, lui dont la dérision n'épargnait personne, surtout pas lui-même. Ne s'était-il pas proclamé "gros dégueulasse" ? Ce personnage qu'il incarnait, cette image qu'il réfléchissait sur son public, c'était lui, disait-il : "la connerie dont je parle, je la sens en moi..." Coluche était un bouffon de génie, au naturel absolu, au langage tout droit sorti de la zone des banlieues. Un clown dont la grossièreté "soulage tout le monde", expliquait-il. Fils d'un immigré italien et d'une mère fleuriste. Michel Colucci naît à Paris en 1944. Il rencontre très tôt le succès. A peine a-t-il participé, à 20 ans, à la création du Café de la Gare, puis créé sa propre troupe, Au vrai chic parisien, qu'il est repéré par l'imprésario Paul Lederman. Il fait dès lors cavalier seul, remplit pendant deux ans Le Gymnase, à Paris, puis les plus grandes salles de province. A la radio, il bat en direct tous les records d'audience. Fin 1980, il annonce sa candidature à l'élection présidentielle. Les sondages le créditent de 16 % des intentions de vote, mais il ne réunit pas le nombre suffisant de parrains. Bête de music-hall, il crève aussi l'écran. Il a tourné pas moins de treize films : Le Pistonné, de Claude Berri, Les vécés étaient fermés de l'intérieur, de Patrice Leconte ; L'Aile ou la Cuisse, de Claude Zidi ; Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, qu'il réalise lui-même ; Tchao Pantin, sans doute son plus beau rôle, qui lui vaut le César du Meilleur acteur en 1983. Comme souvent, le grand provocateur était un grand humaniste. En 1985, il lance les "Restos du cœur". En une seule émission de télévision, il glane 20 millions de francs. De quoi distribuer 8 millions de repas gratuits pendant tout l'hiver et offrir le reliquat des dons à l'abbé Pierre. Il ne connaîtra pas l'hiver suivant : le 19 juin 1986, ce passionné de grosses motos, recordman sur circuit du kilomètre lancé, percute un camion au détour d'un virage, sur une petite route des Alpes-Maritimes. Il est tué sur le coup. Huit ans après, les Restos du cœur nourrissent toujours des centaines de milliers d'exclus. |
|||
|