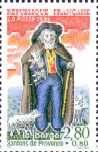

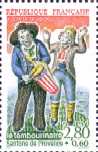



le Tambourinaire
|
Célébrités 1995 : Les santons de Provence.
|
|||||
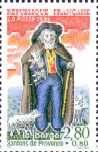 |
 |
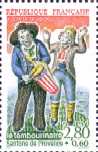 |
 |
 |
 |
| Le Berger | Le Meunier |
Le Ravi et le Tambourinaire |
La Poissonnière | Le Rémouleur | Les Vieux |
|
|
|||||
| Le Berger | |||
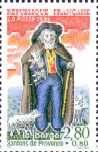 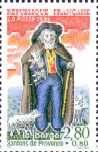 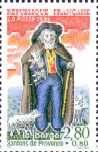 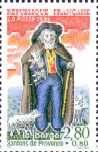 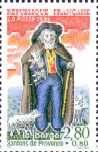 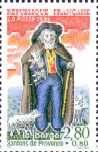 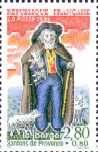 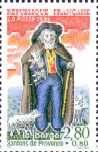
|
|||
|
Couvert de son épaisse houppelande, le berger vient porter devant la crèche, son offrande, un agneau.
Les origines du "Santoun". La légende fait remonter à saint François d'Assise la tradition de la crèche de Noël. Le premier, il aurait obtenu du Pape l'autorisation de représenter la Nativité, la nuit de Noël 1223, avec des personnages et des animaux vivants. Et comme la mère du premier des franciscains était, dit toujours la légende, originaire de Tarascon, les Provençaux seraient donc associés aux lointaines origines de cette cérémonie chrétienne. Laquelle allait donner naissance, des siècles plus tard, à une tradition non moins vivace : les santons, ces figurines d'argile qui se confondent désormais avec l'identité provençale. De nos jours, on associe spontanément les santons aux personnages traditionnels de la vie provençale : le ravi, le tambourinaire, la poissonnière, le meunier... ces anonymes qui accèdent, avec le timbre, au statut de personnages célèbres. Mais c'est bien dans la crèche chrétienne que la société bigarrée des santons puise ses origines. Le mot "santon", du reste, provient du provençal sant (saint), complété du diminutif oun - c'est-à-dire "petit saint". On nomme ainsi en Provence, à partir du XVIIIème siècle, de petites statuettes de bois ou de plâtre représentant une effigie sacrée. Les enfants les utilisent pour peupler leur capelo : petite chapelle personnelle. La crèche que nous connaissons aujourd'hui n'est pas encore entrée dans les foyers. Elle est cantonnée aux lieux consacrés.Et elle n'est pas toujours bien considérée par le clergé, qui craint parfois le développement d'un culte quelque peu idolâtre. Juste avant la Révolution, dans son Tableau historique de Marseille, l'abbé Bonnet parle à propos des crèches de "droleries" que l'on trouve "à Marseille sur des autels des églises paroissiales et autres". L'abbé affirme ensuite : "on doit laisser cet amusement aux enfants qui jouent à la chapelle". Il semble donc que le santon de Provence tire l'une de ses spécificités - sa très petite taille - de l'usage qu'en faisaient initialement les enfants. Personnage sacré à l'origine, il est sous l'Ancien régime une sorte de cousin en réduction des santibelli ("beaux saints"), ces statuettes en plâtre fabriquées en Italie, naïvement et richement décorées, que les puristes du "santonisme" tiendront plus tard pour un symbole de mauvais goût. |
|||
|
| Le Meunier | |||
       
|
|||
|
Qu'il soit à pied ou juché sur son âne, animal sacré de la crêche, le meunier porte toujours un sac de farine à l'épaule.
Des chapelles enfantines aux crêches familiales. Sous la Révolution, les crèches ont disparu avec la fermeture des églises. Elles réapparaissent à Marseille à partir de 1803. Entre-temps, l'interdiction de la messe de minuit semble avoit incité des fidèles à dresser chez eux des petites crèches domestiques, devant lesquelles ils prient la nuit de Noël. Ainsi la chapelle enfantine de Provence se serait-elle muée en crèche familiale. Celle-ci devient vite une tradition populaire dans les foyers provençaux, au point de donner lieu, à Marseille, à une Foire de Noël, qui allait prendre plus tard le nom de Foire aux santons. En témoigne le registre de correspondance du maire de la ville, en date du 3 décembre 1806 : "Autorisé le directeur de la régie des emplacements publics à donner pendant un mois et demi jusques au quinze janvier la permission d'occuper des places sur le grand Cours entre les bancs, pour y vendre des crèches, sucreries et autres menus objets pour amuser les enfants". Au siècle dernier se développent aussi en Provence les crèches publiques, installées en dehors des églises. Traditionnelles, puis parlantes (comme celle de Victor Benoît conservée aujourd'hui au musée du Viel-Aix), animées par des automates ou des marionnettes, dotées de décors de plus en plus travaillés, les crèches publiques deviennent spectacle et attirent un large public. On chante devant certaines des chants de Noël mais on vient aussi s'amuser des saynetes construites autour des personnages en mouvement. Sous la houlette d'entrepreneurs laïcs, les thèmes de Noël se mêlent à ceux de la vie populaire, le chasseur et le pêcheur rejoignent les bergers agenouillés devant l'étable, la faconde provençale enrichit la tradition chrétienne. Un chroniqueur marseillais de 1831 décrit ce mélange de sacré et de profane dans lequel allaient s'épanouir les santons. On "voyait Béthléem, village situé à cent lieues de la Méditerranée et doté d'un port magnifique, avec phare, forteresse et vaisseaux de ligne qui bombardaient la place ; puis des paysans, des laboureurs, des bohémiens, des bergères, costumés à la manière des Provençaux, allaient offrir au nouveau-né des layettes, des langes, des vêtements confectionnés au goût du jour..." |
|||
|
| Le Ravi et le Tambourinaire | |||
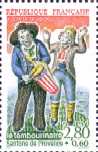 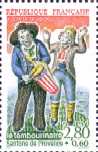 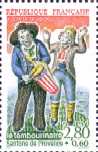 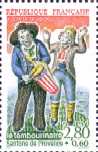 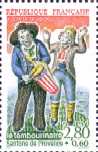 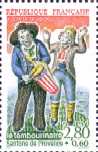 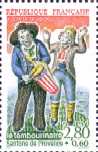 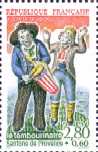
|
|||
|
Le ravi est sans doute le plus connu des santons avec ses bras toujours levés et son air joyeux. Non moins populaire, le tambourinaire animait jadis avec son instrument typiquement provençal, les fêtes villageoises.
Lagnel, le père du santon d'argile. La fileuse, le joueur de flageolet, la lavandière, le dresseur de marmottes... Impossible de citer tous les personnages crées par Jean-Louis Lagnel, le plus ancien fabricant connu de santons d'argile. Lagnel naît à Marseille en 1764. Mentionné comme "peintre", puis "faïencier" et "sculpteur" lors de divers recensements sous la Révolution, il est qualifié de "figuriste" sur son acte de décès, en 1822. La profession de "santonnier" n'apparaîtra que plus tard. C'est pourtant lui qui en fut le précurseur. On doit en effet à Lagnel la création du santon d'argile, c'est-à-dire le véritable santon populaire, de petite taille et au coût de fabrication modeste. Avant lui, les crèches familiales étaient rares et réservées à une société aisée. Présentées souvent dans des boîtes vitrées elles s'ornaient de statuettes en matériaux très divers : bois, plâtre, mie de pain pétrie, cire... Avec Lagnel et après lui va s'affirmer l'artisanat spécifique du santon de Provence. Lagnel maîtrisait parfaitement la technique du moulage, qui lui permit de développer la fabrication en série de santons d'argile. Excellent modeleur et mouleur, il était aussi un peintre remarquable, comme en témoignent sur ses figurines le rendu des drapés et l'expression des visages. Il a pratiqué les deux types de création que perpétuent les santonniers d'aujourd'hui : le santon "simple", moulé d'une seule pièce, et le santon "détaché", dont les membres supérieurs sont moulés séparéément et collés ensuite sur le corps avec de la barbotine. De son vivant, la production de Lagnel fut considérable. Il a crée des dizaines de santons, sacrés et profanes, multipliant les personnages mais aussi les postures, les accessoires, les expressions... De nombreux moules ont permis d'accroître la notoriété de son œuvre. Ainsi grâce à une technique permettant l'édition en séries, le santon devint rapidement le reflet de la diversité sociale de son temps : un personnage familier, représentant tous les types de la population locale, s'installant à demeure dans les crèches familiales, aux côtés des personnages traditionnels de la Nativité. |
|||
|
| La Poissonnière | |||
       
|
|||
|
Balance romaine accrochée à la ceinture, main sur la hanche, menton haut : voici la poissonnière dans une attitude typique qui dénote une faconde légendaire..
La Foire aux santons de Marseille. "Là, on trouve des saints de toutes les tailles, des Vierges de toutes les grandeurs, des rois dorés de toutes les manières. On y trouve aussi des branches de laurier ornées de leurs baies, des lampes en verre, des oiseaux en papier, des moutons, des pâtres, des joueurs de cornemuse et de tambourin..." Ainsi le Messager de Marseille décrit-il en décembre 1831 la Foire aux santons, qui se tient alors sur le cours Belzunce. Sur les étals où les Marseillais viennent se fournir à l'approche de Noël, les santons représentant le petit peuple de la vie locale se mêlent aux personnages de la Nativité. La tradition de la crèche familiale est alors en plein essor dans les foyers de Provence. Le succès populaire de la Foire aux santons lui valut de changer plusieurs fois d'emplacement - jusqu'aux allées de Meilhan, en bordure de la Canebière, où elle se tient encore aujourd'hui. Dans les années 1850 les marchands se plaignent d'être exposés en plein vent et obtiennent l'autorisation d'installer des abris pour se protéger. Une gravure de l'Illustration en 1859. Entre les pimpantes baraques de la "Foire aux Santouns", surmontées de frontons variés et fréquentées par des Marseillais de toutes conditions. La presse parisienne s'intéresse au phénomène et le Grand Dictionnaire universel du XIXème siècle, de Pierre Larousse, consacre même un long article à la crèche marseillaise. La popularité croissante du santon va de pair avec sa laïcisation" sur les étals des marchands. "En fait de costume oriental, on voit aux hommes de larges vestes et des bonnets de coton ; aux femmes, des robes de demi-laine et pour coiffure, le large feutre rond à galon doré", écrit en 1868 la Gazette du Midi. Quelques années plus tard, le même journal déplore les entorses à la tradition et "l'invasion des santons modernes" : "Il n'est pas jusqu'au ravi que l'on n'ait totalement dépaysé en l'entourant d'animaux de toute espèce, parmi lesquels une girafe". Si la foire aux santons de Marseille fut la première - la chronique marseillaise fait remonter les premiers étals à 1803 - le phénomène se répandit dès le siècle dernier en Provence. Les foires d'Aubagne et d'Aix, en particulier, sont devenues - et demeurent aujourd'hui - de grands rendez-vous des amateurs de santons, à l'approche de Noël. |
|||
|
| Le Rémouleur | |||
       
|
|||
|
Représentant des petits métiers traditionnels "l'amoulaïre", personnage bonhomme et populaire, est parfois crédité d'un certain penchant pour la boisson et dès lors flanqué d'une gourde.
Un artisanat florissant. Au début de ce siècle, l'artisanat santonnier est une activité florissante qui, après Marseille, a conquis Aix, Aubagne, Avignon, Carpentras, Apt, Toulon... On fabrique les santons par milliers, avant de les expédier, vers les permiers jours de décembre, dans tous les villages de Provence, où les enfants les découvrent dans les vitrines des épiciers, des confiseurs, des libraires... La création de santons a maintenant ses maîtres, ses ateliers spécialisés, ses dynasties familiales - dont beaucoup perdurent aujourd'hui. Parmi ces grandes lignées : celle fondée par Thérèse Neveu. La première création de cette santonnière aubagnaise est entrée dans la légende. Il s'agit de Margarido, inspirée d'une provençale qui venait chaque semaine à Aubagne rendre visite à son cousin le curé Blanc. Vêtu d'un manteau de ramoneur, coiffé de dentelles, cabas dans une main et parapluie rouge dans l'autre, le personnage a donné lieu à d'infinies interprétations. Avec Thérèse Neveu et ses contemporains, le santon se rapproche de l'univers quotidien des Provençaux. Il représente moins les personnages du temps jadis et davantage ceux d'une tradition plus proche, plus familière. Toutes les figures locales, les petits métiers, les particularités vestimentaires sont ainsi croqués. Pour mieux coller à son modèle, le santon est de plus en plus souvent habillé de tissu et nanti d'accessoires - ce qui suscite de nouvelles spécialités professionnelles. Peu à peu, la production se diversifie. Elle va du santon d'art, pièce unique réservée à des collectionneurs, au santon moulé en grande série, qui ne vivra que le temps d'une crèche, en passant par le "santon-puce", de moins de deux centimètres. De nos jours, on recense environ 200 ateliers de santonniers en Provence et aux alentours, concentrés pour la plupart dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-de-Haute-Provence et du Vaucluse. Les santonniers ont leur syndicat et leur salon internationnal, en Arles. Les santons ont leurs espaces réservés dans les musées (celui du Vieux-Marseille possède un très important fonds ancien), leurs expositions, leurs grandes crèches de Noël dans les églises, leurs foires hivernales et même estivales. |
|||
|
| Les Vieux | |||
       
|
|||
|
Les vieux souvent incarnés dans les pastorales par Margarido et Jordan, se chamaillent sans cesse avant de se réconcilier devant l'Enfant-Jésus.
Quelques santons consacrés par la tradition. N'est pas santon qui veut. Les "vrais" santons représentent des personnages consacrés par la tradition de la crèche provençale. Une typologie souvent inspirée des pastorales pièces de théatre jouées par des "santons vivants". Ces figurines d'argile doivent aussi leur crédibilité historique et leur statut de représentants quasi officiels de l'identité provençale aux promoteurs du "santonisme". Parmi eux, dans la première moitié de ce siècle : Elzéard Rougier et Marcel Provence, dont les écrits et les initiatives ont contribué à faire entrer le santon dans le champ du Félibrige, cette école littéraire fondée en Provence dans la lignée de Frédéric Mistral. Autour des personnages de la tradition évangélique (l'Enfant-Jésus, la Vierge et saint Joseph, les rois mages, l'âne et le boeuf), la crèche provençale réunit de nombreux personnages profanes, formant la cohorte des petits métiers et des porteurs d'offrandes. La plupart n'ont pas de nom et sont désignés par leur activité ou un signe particulier : le bohémien (lou boumian), vêtu d'une grande cape et portant un couteau de brigand ; l'aveugle et son fils, toujours réunis en "santon double", l'adolescent guidant le vieillard qui a perdu la vue après avoir trop pleuré la mort d'un autre fils. Le maire est le seul notable admis à la crèche. Il est généralement représenté en costume d'apparat, ceint de l'écharpe tricolore. Le chasseur, blagueur invétéré, constitue un des anachronismes de la crèche. En effet, il est évident que les armes à feu n'étaient pas inventées à la naissance du Christ, mais ce santon, le feutre sur l'oreille et la gibecière en bandoulière, fait partie de la tradition provençale et s'est imposé alors dans la crèche. Le chasseur ainsi que le pêcheur sont les premiers personnages de la crèche à avoir exercé une activité de pur loisir, sans porter de présents... Sans oublier la fileuse, le mitron, les bacherons.. tout un petit peuple aujourd'hui disparu, qui revit chaque année grâce à l'une des rares traditions qui échappent à l'usure du temps. |
|||
|