
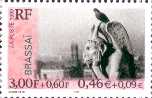




|
Célébrités 1999 : Photographes.
|
||
| Doisneau | Brassaï | Lartigue |
 |
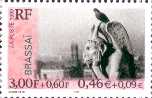 |
 |
 |
 |
 |
| Cartier Bresson | Atget | Nadar |
|
|
||
| Doisneau | |||
       
|
|||
|
Robert Doisneau naît à Gentilly le 14 avril 1912. En ce début de siècle, la banlieue offre un paysage constitué de jardins maraîchers, de petits commerces et d'usines, où domine pourtant le sombre. Cet espace, sis entre Paris et la campagne, représente, pour cet artisan aux 500.000 négatifs, un terrain de prédilection. Élève de l'école Estienne, le jeune Robert acquiert une formation de lithographe qui éduque son œil à penser l'image. Muni d'un appareil photographique emprunté, Doisneau apprivoise ses premières images : la roue cassée d'une bicyclette, des affiches, des pavés. En 1931, devenu l'assistant d'André Vigneau, il pénètre dans l'univers de l'avant-garde. Il s'achète alors son premier appareil : un Rolleitlex 6x6. Tout comme le fait Vigneau, il apprend à dompter la lumière artificielle pour mieux approcher les formes. Des modèles humains apparaissent sur ses clichés. En 1932, le contraste est saisissant qui montre de frêles gamins devant des décors écrasants. Photographe salarié des usines Renault en 1934, il côtoie les travailleurs dont il montre le quotidien avec respect et tendresse. Licencié en 1939 pour "retards répétés", il devient photographe illustrateur indépendant. Sa rencontre avec Charles Rado est déterminante : il entre à l'agence Rapho que celui-ci vient de fonder. Pendant la guerre, il met son savoir-faire au service de la Résistance en fabriquant des faux papiers. L'après-guerre qui voit l'éclosion de multiples revues lui offre l'occasion d'exprimer par ses photographies un vibrant hommage à la classe populaire. Ses prises de vues lui permettent de rencontrer Picasso, de se lier d'amitié avec Blaise Cendrars qui est à l'origine de son premier livre, La Banlieue de Paris, puis avec Jacques Prévert dont il deviendra un compagnon de flânerie, promeneurs complices d'un Paris poétique et mystérieux. Exposé au Museum of Modem Art de New York dès 1951, il connaît un succès international. En couleur parfois, en noir et blanc le plus souvent, Robert Doisneau, "pêcheur d'images", chantre des vies modestes, des amoureux, des enfants, nous laisse un témoignage humaniste inoubliable. |
|||
|
| Brassaï | |||
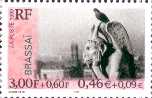 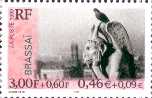 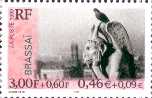 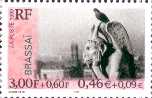 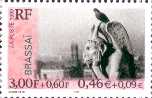 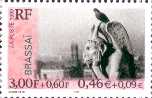 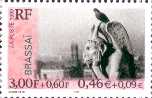 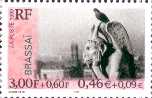
|
|||
|
Né en 1899 à Brasso, en Transylvanie, Gyula Halâsz forge son pseudonyme d'artiste sur le nom de sa ville natale. Il étudie la peinture aux académies des Beaux-Arts de Budapest et de Berlin-Charlottenburg. En 1924, il vient à Paris où il sculpte, dessine, écrit, collectionne des timbres. Émerveillé par la capitale, ce noctambule voudrait, par sa peinture, rendre avec justesse cette obscurité, la vie de ce monde secret. Qu'il s'agisse de voyous, de voyageurs de l'abîme ou de quartiers aux murs lépreux, tout cet univers souterrain lui semble authentique, vivant. Il veut en être le témoin. Comme le dit François Mauriac : "Brassaï est un révélateur des microcosmes inconnus dont le temps accumule invisiblement les vestiges". Et Brassaï d'avouer : "C'est, poussé par le désir de traduire en images tout ce qui m'émerveillait dans ce Paris nocturne, que je devins photographe". Dès lors, muni de son appareil Voigtlander, il saisit un monde interlope. Il inquiète. Pour convaincre si besoin, il présente quelques clichés obtenus de nuit : preuves tangibles de ses activités. Dostoïevski et ses personnages l'attirent. Comme eux, il sera le témoin de l'insolite, des mauvais garçons qui arpentent la capitale dans les années 30. Paris de nuit paraît en 1933, Graffiti en 1960. Il collabore à la luxueuse revue d'art Le Minotaure, fait la connaissance de Picasso. Conversations avec Picasso est publié en 1964. Plus que foisonnant d'anecdotes, ce livre offre une meilleure approche de l'art, de l'artiste et de son génie. Paris secret des années 30 paraît en 1976, Les Artistes de ma vie en 1982. Photographe célébré à plusieurs reprises au Museum of Modern Art de New York, Brassaï connaît un triomphe immense en 1974 en Arles, lors des Rencontres internationales de la Photographie. Son ami Henry Miller, parlant de lui, évoquait un "œil vivant". Cet "œil vivant" qui, à l'affût du monde, du moindre mouvement, sut capter l'instant. Brassaï nous laisse un précieux témoignage. Il est l'historien d'une époque, sans lui engloutie. |
|||
|
| Lartigue | |||
       
|
|||
|
Jacques Lartigue naît à Courbevoie le 13 juin 1894. Dès l'âge de 6 ans, le jeune garçon prend des photographies avec l'appareil de son père. Ses clichés sont parfois accompagnés d'impressions personnelles. Deux ans plus tard, muni de son premier appareil - une chambre 13x18 en bois - il prend des photographies qu'il développe et engrange dans des albums, crayonnant en marge des légendes : façons de capturer l'instant pour ce collectionneur infatigable qui thésaurisera ainsi 250.000 clichés.
Dans les années 50, Lartigue vend des images de ses amis à la presse. C'est ainsi que le monde entier peut découvrir ses clichés de Picasso ou Cocteau par exemple. Il expose à Paris aux côtés de Brassaï, Man Ray, Doisneau, à la galerie d'Orsay. Passionné par le cinéma, il photographie les tournages de plusieurs films de Jacques Feyder, Abel Gance, Robert Bresson, François Truffaut et Federico Fellini...
|
|||
|
| Cartier-Bresson | |||
       
|
|||
|
Né à Chanteloup, en Seine-et-Marne, le 22 août 1908, Henri Cartier-Bresson étudie à l'école Fénelon puis au lycée Condorcet. Très jeune déjà, il se passionne pour la peinture et fréquente l'atelier d'André Lhote. En 1928, il se rend à l'université de Cambridge où il étudie la peinture et la littérature. Et c'est en 1931 qu'il commence à photographier, se munissant dès 1932 d'un Leïca qu'il ne quittera plus. Henri Cartier-Bresson parcourt le monde. Voyageur insatiable, il ne se lasse pas. L'Inde, la Chine, l'Union soviétique, le Mexique le fascinent. Celui qui dit être un artisan fait du photojournalisme. Veillant à rester en prise avec ce qui se passe dans le monde, il ne se contente pas de recueillir des faits, mais sait donner à l'éphémère instantané, valeur permanente. Avec son fanmeux Leïca, Henri Cartier-Bresson pratique, à l'instar des surréalistes qu'il fréquenta, une écriture automatique appliquée au monde de l'image. Prélevant dans le réel sans jamais l'altérer, le photographe chez lui ne se veut pas esthète en quête d'une belle copie, mais voyant avide, saisissant la banalité apparente de la vie pour mettre en lumière la réalité secrète et révéler une vérité essentielle. Photographier, dit-il, "c'est retenir son souffle quand toutes nos facultés convergent pour capter la réalité fuyante; c'est alors que la saisie d'une image est une grande joie physique et intellectuelle", ou encore : "C'est mettre sur une même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur", et de conclure : "C'est une façon de vivre". Depuis 1974, celui qui a incontestablement donné un tour nouveau à la photographie se consacre tout particulièrement au dessin qui, pour lui, est méditation. |
|||
|
| Atget | |||
       
|
|||
|
Né à Libourne le 12 février 1857 dans une famille modeste, le jeune Eugène reçoit une éducation classique. Assoiffé de culture, attiré par les Arts, il se passionne pour le théâtre et souhaite y faire carrière. Il tente le Conservatoire de Paris mais, engagé dans l'armée pour cinq ans, ne peut en suivre les cours. Il en conservera une amertume inextinguible. Une autre forme d'art le retient : la peinture. Mais, là encore, le bilan n'est pas glorieux; l'homme perd confiance en lui et en son talent d'artiste. Pourtant, l'artiste existe et ne le saura pas. Loin des pictorialistes, Atget fixe la vie avec sincérité et va, infatigablement, photographier ce qui l'inspire. Individualiste, solitaire, Atget arpente Paris et ses environs, muni d'une chambre à soufflet 18x24, de deux douzaines de plaques de verre, d'un pied de bois. Lesté d'une vingtaine de kilos de matériel, il aime saisir le pittoresque dans la clarté du petit matin : les petits marchands des quatre saisons, un fiacre, un heurtoir, la Bièvre à la Porte d'Italie. S'il photographie l'homme, Atget se plaît à offrir un monde impénétrable : rue vide, fenêtres ouvertes sur des intérieurs muets ou obscurs, ou bien un monde extravagant avec cet assemblage de chaussures pendues à la vitrine d'une boutique de la rue du Petit-Pont. Saisissant l'élément émouvant, le détail inhabituel, l'artiste, habité par le réel, sait faire naître l'imaginaire. Soucieux de nous donner des images vraies, le photographe capte tout : le beau, le laid. L'humour est au rendez-vous, la technique aussi. Le simple éclairage fourni par une fenêtre donnant sur la cour permet à Atget d'offrir une étonnante vue de dos d'une fille de maison close. Le premier à avoir su saisir sur le vif la vie de tous les instants, cet homme de théâtre pour son sens du décor nous a laissé une impressionnante collection artistique et documentaire. Ce "forçat de l'objectif", s'il appartient bien au XIXème siècle pour sa technique, obtient les suffrages du XXème siècle. Il est un reporter du rêve et de la réalité. |
|||
|
| Nadar | |||
       
|
|||
|
Gaspard-Félix Tournachon voit le jour à Paris le 5 avril 1820. Tout en suivant des cours de médecine, il travaille comme commis libraire, feuilletoniste. Il signe Tournadar puis Nadar lorsque, à 21 ans, il dessine et écrit pour différents journaux. À 25 ans, il publie son premier roman, La Robe de Déjanire, et côtoie déjà bon nombre d'hommes de lettres. Caricaturiste dans plusieurs revues, il excelle en cet art et son "Panthéon Nadar" offre une lithographie de 300 portraits de célébrités en procession derrière Victor Hugo : tous brossés avec ingéniosité et finesse d'analyse. La ressemblance morale doit être. Nadar, afin de ne pas lasser ses modèles, a recours à la photographie. Et cet homme orchestre, s'il caricature sa vie durant, écrit abondamment romans et surtout nouvelles. Mais son art ne s'arrête pas là. Cet homme qui a lancé son frère Adrien dans la photographie s'en éprend et donne toutes ses lettres de noblesse à un art encore méconnu, transcendant ce qui n'était alors qu'une technique en création artistique. Les intellectuels d'alors affectent bien souvent à l'égard de la photographie dédain ou désinvolture. Baudelaire, lui-même réticent, sait reconnaître en Nadar le créateur, l'artiste, lorsqu'il dit : "Nadar, c'est la plus étonnante expression de vitalité". Et cela est, puisque l'artiste introduit l'art du portrait. Il sait rendre "la ressemblance intime". Nadar regarde les gens, il ne vole pas l'instant, mais au contraire le sacralise dans un grand élan amical. Ce magicien parle du "côté psychologique de la photographie". Cet homme qui nourrit une véritable passion pour la littérature, ce caricaturiste hors pair, réussit en 1858 la première photographie aérienne.Mettant au point l'éclairage électrique, il peut photographier, la nuit et en lumière artificielle, catacombes et égouts de Paris. L'Exposition universelle de 1900 offrit une rétrospective de sa prodigieuse carrière de photographe. Reconnaissance magistrale méritée pour celui qui sut faire accéder la photographie au rang d'Art. |
|||
|