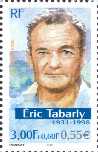
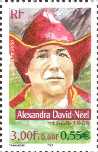
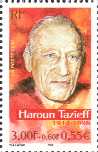
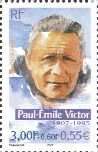

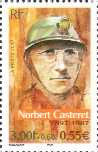
Tabarly
David-Néel
Tazieff
Victor
Cousteau
Casteret
|
Célébrités 2000 : Aventuriers.
|
|||||
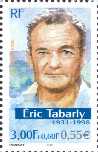 |
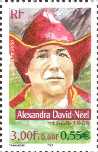 |
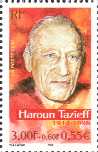 |
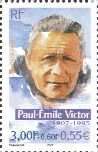 |
 |
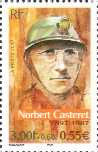 |
|
Eric Tabarly |
Alexandra David-Néel |
Haroun Tazieff |
Paul-Emile Victor |
Jacques-Yves Cousteau |
Norbert Casteret |
|
|
|||||
| Eric Tabarly (1931-1998) | |||
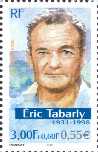 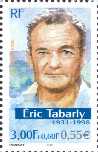 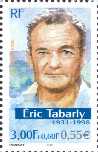 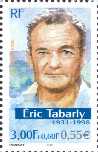 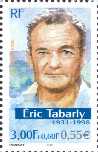 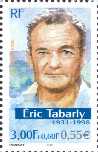 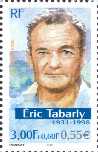 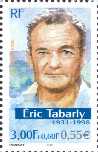
|
|||
|
Éric Tabarly est né à Nantes le 24 juillet 1931. Il meurt en mer dans la nuit du 12 au 13 juin 1998 alors qu'il naviguait vers l'Écosse à bord du célèbre Pen Duick. Pour beaucoup de navigateurs, Éric Tabarly incarne l'avènement du nautisme français moderne. Les premières armes de "Tabarly navigateur" se sont faites à bord de l'Annie, le bateau familial, alors qu'il était tout juste âgé de trois ans. En 1938 , son père Guy achète le Pen Duick, premier du nom, un cotre en bois de 15 mètres. Ce nom mythique de Pen Duick restera dès lors définitivement attaché à Éric et, à travers lui, à la mémoire de son père. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1952, Éric Tabarly s'engage dans l'aéronavale et convainc son père de lui céder le bateau familial. Il décide de le remettre à flot, de lui rendre vie et sens. En 1958, Tabarly est reçu au concours d'entrée de l'École Navale. Il faut attendre la Transat anglaise de 1964, qu'il remporte à bord du Pen Duick II, pour que son nom entre dans la légende. En effet, après 27 jours de traversée en solitaire, il pulvérise le précédent record de 1960 et rejoint Newport en 40 jours et 12 heures. En 1965, Éric Tabarly est détaché au ministère des Sports pour représenter son pays dans les grandes courses internationales. C'est alors que l'on découvre une nouvelle et brillante génération de navigateurs français qui ont tous effectué leur service militaire comme équipiers du Pen Duick : Philippe Poupon, Marc Pajot, Titouan Lamazou... Le troisième Pen Duick conduira Tabarly vers de très belles victoires, dont la première place du championnat anglais RORC et le célèbre Fastnet. La saga des Pen Duick se poursuit, toujours accompagnée de modifications audacieuses de la part de leur créateur. En 1969, Éric Tabarly décide de participer à la Transpacifique en solitaire en reliant San Francisco à Tokyo. L'occasion lui est offerte de mettre en chantier le Pen Duick V, un monocoque qui atteint la longueur maximale de 35 pieds. Il remporte la course avec 11 jours d'avance sur le second. Durant les années suivantes, succès et victoires, nouveaux chantiers et bateaux verront le jour. La victoire de 1976 à bord du Pen Duick VI, maxi prévu pour un équipage de 14 hommes, restera particulièrement chère au cœur de Tabarly. Par la suite, sa carrière de skipper se poursuivra, notamment à bord du Paul Ricard, du Côte d'Or, du Bottin Entreprise et du bateau La Poste. La dernière course de Tabarly aura lieu en 1997, sur le 60 pieds d'Yves Parlier où il embarque en tant qu'équipier. Les deux hommes remportent la course. En juin 1998, Tabarly et ses Pen Duick sont entrés dans la légende exigeante du monde maritime. |
|||
|
| Alexendra David-Néel (1868-1969) | |||
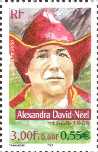 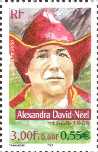 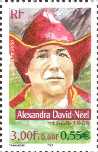 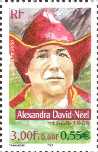 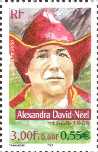 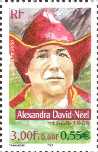 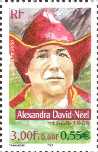 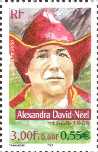
|
|||
|
Née à Paris en 1868, Alexandra David-Néel est une des rares femmes du siècle dernier à s'être fait connaître et surtout reconnaître dans le monde très viril de l'aventure et de l'exploration. Dès l'enfance, Alexandra affirme son désir de liberté en multipliant les petites fugues dans le voisinage. Mais son premier départ date de 1883 et a pour but l'Angleterre. Deux ans plus tard, elle quitte Bruxelles où ses parents se sont installés et se rend en Suisse qu'elle visite seule, à pied Les départs audacieux se succèdent alors très vite. À la suite d'un séjour à Londres, la jeune femme s'initie aux philosophies orientales tout en se familiarisant avec la langue anglaise. En 1889, à 21 ans, elle poursuit des études en auditrice libre à la Sorbonne, aux Langues orientales et au Collège de France. Elle pénètre aussi de nouveaux milieux -franc-maçonnerie, cercles féministes et anarchistes. Elle fréquente assidûment le musée Guimet et c'est là que naît sa vocation d'orientaliste de terrain. Vers 1890-1891, Alexandra découvre l'Inde. Cette première rencontre des philosophies d'Asie la conforte dans sa vision de la modernité de ces courants de pensée millénaires qu'elle souhaite réactualiser: De retour sa famille ne pouvant plus l'aider elle entreprend alors une carrière de chanteuse d'opéra lyrique et chante à Hanoi et Haiphong en 1895-1896. En 1900, l'infatigable voyageuse s'attarde en Afrique du Nord où elle fait la connaissance de Philippe Néel, son futur mari. Mais le rôle d'épouse ne lui convient guère. L'exploratrice repart donc seule pour un voyage qui durera quatorze ans. Elle parcourt des milliers de kilomètres à travers l'Extrême-Orient et une grande partie de l'Asie centrale, s'initie au sanskrit, au tibétain et côtoie les plus grands penseurs. En 1912, date de sa première expédition au Tibet, Alexandra David-Néel sympathise avec le souverain du Sikkim, un petit État himalayen, et approfondit sa connaissance du bouddhisme tantrique. Dans un monastère, elle rencontre en 1914 le jeune Yongden qui deviendra son fils adoptif. Elle se retire avec lui dans un ermitage et suit les enseignements d'un yogi. Après un exil forcé au Japon, elle repart pour Pékin. Avec son fils adoptif et un Lama, elle parvient à franchir la frontière du Tibet et séjourne deux mois à Lhassa. Après ces années de pérégrinations qui ont définitivement marqué sa vie, de retour en France, l'exploratrice choisit de s'installer à Digne en 1928, et entreprend l'écriture de ses Mémoires. Tenaillée par l'idée d'un retour en Asie, elle repart en 1937 avec le Lama Yongden. En Chine, ils se consacrent à l'étude, la méditation et à l'errance malgré la guerre sino-japonaise. Elle rentre en 1946, âgée de 82 ans. En 1955, son fils Yongden meurt. Tout en nourrissant le projet d'un nouveau voyage, elle s'attelle à l'écriture. Jusqu'à la veille de sa mort, le 8 septembre 1969, et malgré son grand âge, cette centenaire pense à revenir au Tibet dans ce perpétuel mouvement de retour qui a marqué sa longue vie. |
|||
|
| Haroun Tazieff (1914-1988) | |||
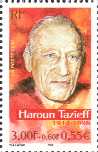 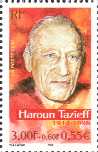 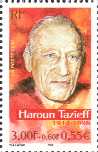 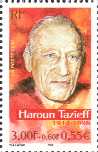 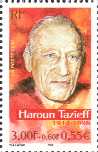 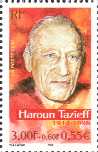 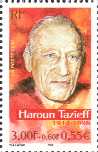 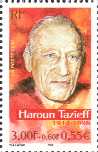
|
|||
|
Haroun Tazieff est né russe à Varsovie en 1914. Il a parcouru le monde et 83 années du XXème siècle dans un mouvement intense et passionné. Dès sa prime enfance, sa mère, jeune veuve d'un médecin tué au commencement de la guerre de 1914, fuit, avec lui, sur les routes de l'exil qui les mènent de la Russie (Petrograd, Tbilissi), à Paris puis à Bruxelles où ils s'installèrent durant plusieurs années. Cette enfance a-t-elle donné son allure et ses motifs à ce que sera tout le reste de son existence? Rares sont les cratères de la planète qui ont échappé à ses explorations, depuis ce mois de mars 1948, dans la chaîne des Virunga, où, émerveillé par le prodigieux spectacle d'un volcan en éruption, il décida de troquer son équipement de géologue pour celui de volcanologue qu'il n'abandonnera jamais. Etna, Stromboli, Erebus (l'exceptionnel volcan de l'Antarctique), Ambryrn, Tana aux Nouvelles-Hébrides, Niragongo, Kituro, l'Afar où fut mesuré, à l'endroit prévu, l'écartement des plaques tectoniques: à ces noms sont désormais associés les exploits d'où résulte son immense notoriété internationale. Mais pour Haroun Tazieff, découverte et conquête devaient nourrir la connaissance scientifique; celle-ci, en retour; devait se mettre au service de la défense et de la protection des hommes, de leur environnement de la nature. Son souci a été ainsi de rendre accessibles et de diffuser les expériences et le savoir; parfois contesté, qu'il avait acquis dans ces lieux où la terre sent le soufre, gronde, s'enflamme, tremble, mais aussi dans ses engagements de résistant contre le nazisme ou encore dans les sports qu'il pratiqua -la boxe, l'alpinisme et le rugby en particulier. Ses nombreux ouvrages, ses publications scientifiques, ses documents audiovisuels, ses rapports d'études officiels portent témoignage de ce souci, bien souvent turbulent, toujours attachant, d'être présent aux évolutions du monde dont il a été un explorateur actif et attentif, un aventurier autant qu'un homme de science. |
|||
|
| Paul-Emile Victor (1907-1995) | |||
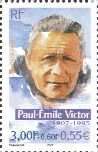 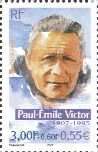 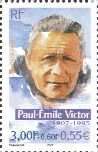 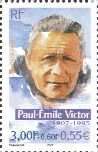 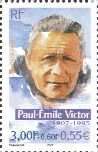 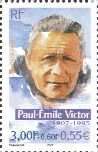 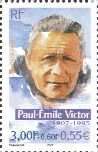 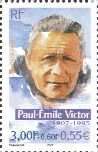
|
|||
|
Jurassien d'origine, Paul-Émile Victor est né à Genève en 1907. Il est l'un des plus grands explorateurs français du siècle, de ceux qui, comme Tazieff, Cousteau ou Casteret, ont consacré leur vie entière, leurs compétences et leurs talents, non seulement à repousser les limites et les zones incertaines de la connaissance de la planète, mais aussi à faire rêver toute l'humanité et à susciter nombre de vocations de découvreurs. Ses terrains d'exploration, dès 1934, avec l'expédition de Charcot, s'étendirent sur les immensités de la calotte glaciaire du Groenland. Il y reviendra à plusieurs reprises, mettant en œuvre la formation d'ethnologue qu'il avait acquise auprès de Marcel Mauss, son maître au musée de l'Homme. Comme son ami Lévi-Strauss, Paul-Émile Victor concevait une "ethnologie amoureuse", une ethnologie animée par l'amour et le respect des hommes et de leurs milieux. A ses yeux, l'ethnologie devait "coller" au terrain, au plus près de la nature, des populations et de leurs cultures. Ses engagements en faveur de la défense des hommes et de leur environnement se situent dans le droit fil de cette conception de la recherche et de l'action. Lors de la Seconde Guerre mondiale, son rôle d'explorateur se conjugue à celui de conseiller auprès des troupes américaines en Alaska et en Antarctique. En 1947; il crée, avec le soutien du gouvernement français, les Expéditions Polaires Françaises, qui permettront à des milliers de scientifiques et de techniciens de travailler en Arctique (Groenland) comme en Antarctique (Terre Adélie). Paul-Émile Victor a pris le temps de construire une œuvre où se manifestent ses talents d'observateur précis et d'écrivain passionné. La liste est longue d'ouvrages, de récits qui rappellent un parcours de vie d'une exceptionnelle richesse. Le premier, Boréal, date de 1938, suivi de Banquise en 1939. La Civilisation du phoque (1993) et Dialogues à une voix (1995) sont les derniers titres qu'il ait publiés. Ses articles scientifiques et de vulgarisation traduisent également l'extrême diversité et la continuité de son travail d'homme de science. |
|||
|
| Jacques-Yves Cousteau (1910-1997) | |||
       
|
|||
|
Jacques- Yves Cousteau est né le 11 juin 1910 en Gironde, à Saint-André-de-Cubzac. Pendant près d'un demi-siècle, le nom du commandant Cousteau a été associé à la silhouette longiligne de l'homme au bonnet rouge, au nom de son bateau, la Calypso, à d'incroyables images venues des fonds marins du monde entier. La carrière maritime de Cousteau a débuté en 1930 avec sa promotion à l'École Navale. Il la poursuit jusqu'en 1957 dans la Marine nationale. Entre-temps, il rencontre à Toulon un autre officier de marine et un champion de pêche sous-marine. Ensemble, ils élaborent un premier appareil rudimentaire de plongée. En 1942, le jeune officier qu'il est encore réalise son premier film sous-marin tourné en apnée qui préfigure son futur long métrage, Le Monde du silence, tourné avec Louis Malle et qui remportera la Palme d'or du festival de Cannes en 1956. En 1943, il poursuit ses recherches et met au point avec Émile Gagnan un détenteur qui fournit de l'air à la demande au plongeur. Les premières plongées avec un scaphandre autonome auront lieu en 1944 au large de Marseille alors que Cousteau et ses acolytes s'illustrent comme les premiers hommes à se déplacer librement dans la mer. En 1950, il arme la Calypso et effectue à son bord les premières croisières en Méditerranée et en mer Rouge. Avec l'ingénieur André Laban, il perfectionne la première caméra sous-marine en 1951 et la Calypso devient navire océanographique. En 1953, il prend les premières photos sous-marines à grande profondeur. En 1954, il découvre du pétrole dans le golfe Persique. Enfin, c'est en 1957 qu'il quitte la Marine avec le grade de commandant en même temps qu'il est nommé directeur du musée océanographique de Monaco. Les années se suivent et les expériences de Cousteau se succèdent sans relâche. En 1958, la soucoupe de plongée SP 350 qui peut mener deux équipiers à 350 mètres de profondeur, effectue sa première sortie. A chaque nouvelle tentative, Cousteau et son équipe prélèvent des échantillons, ramènent des images et se sensibilisent aux questions de l'équilibre naturel. Ce travailleur acharné à l'imagination fertile met au point des programmes étonnants comme les "Maisons sous la mer" ou les "puces de mer", des soucoupes monoplaces qui descendent jusqu'à 600 mètres de profondeur. En même temps, il éveille la curiosité du grand public à ses propres émerveillements par le biais de sa série télévisée: L'Odyssée du commandant Cousteau, de 1966 à 1970. Dès 1970, il s'investit d'un nouveau rôle et se charge d'alerter les pouvoirs publics sur la fragilité de l'équilibre marin. Ses voyages d'études donnent lieu à des publications comme cette encyclopédie éditée en 1973-1974. La même année, la Fondation Cousteau voit le jour aux États-Unis. les expéditions se poursuivent à travers tout le continent En 1984, la Calypso est assortie de l'Alcyone, navire écologique équipé de deux turbovoiles. En 1988, Cousteau est élu à l'Académie française. Ses nombreuses observations l'incitent en 1991 au lancement d'une campagne baptisée le Droit des générations futures. l'année suivante, il participe activement à la conférence de Rio sur l'environnement et devient membre du Haut Conseil auprès du secrétaire général des Nations Unies. Sa dernière mission le mènera au lac Baïkal, de 1996 à sa mort en 1997. l'Équipe et la Fondation Cousteau poursuivent leurs études partout dans le monde, grâce à quarante années de travaux précis et bénéfiques visant à la sauvegarde de la planète. |
|||
|
| Norbert Casteret (1897-1987) | |||
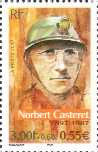 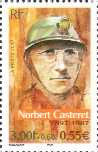 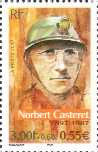 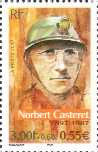 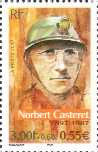 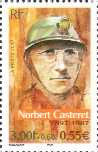 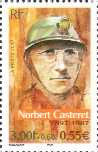 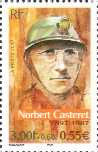
|
|||
|
Norbert Casteret, né en 1897 à Saint-Martory en Haute-Garonne, a laissé le souvenir d'un grand spéléologue. Ses explorations et ses découvertes de sites souterrains et archéologiques sont évaluées à deux mille environ. Il occupe dans l'histoire récente de la spéléologie, une place de pionnier comme Édouard Alfred Martel, l'un des fondateurs de la spéléologie française dont Casteret honore l'action et le souvenir par une biographie. Les principaux terrains d'exploration et d'observation de Norbert Casteret se trouvent dans les Pyrénées, toutes proches des lieux où se passe son enfance. On lui doit notamment la mise en évidence, en juillet 1931, des véritables origines de la Garonne. Par une expérience de coloration des eaux, il apporte la preuve que l'une des sources de la Garonne, celle qui est la plus abondante en été, est issue des glaciers de la Maladeta. Disparaissant de la haute vallée de l'Esera par le Trou du Toro, le torrent passe sous la montagne de la Tusse Blanche, ressort capricieusement dans la vallée voisine, le Val d'Aran, par les résurgences des Goueils de Joucou, et, rejoignant l'autre Rio Garona, arrive en France au Pont-du-Roi. Il avait identifié et localisé quelques années auparavant, en 1922, la cité gallo-romaine de Calagurris. Grâce à lui, la caverne de Montespan a rendu à la curiosité des hommes ses statues considérées comme les plus anciennes du monde: un lion, un ours sans tête, des petits chevaux sculptés dans la glaise (1923). le nom de Norbert Casteret demeure attaché au gouffre Martel, en Ariège (1933), au gouffre Friouato dans le Moyen Atlas (1934), à celui de la Henne-Morte en Haute-Garonne, à la Pierre-Saint-Martin entre Pyrénées-Atlantiques et Navarre... De même, les études qu'il a menées entre 1936 et 1966 sur les mœurs et les comportements des chauves-souris, en relation avec le Muséum de Paris, constituent des références scientifiques obligées. Comme l'attestent les témoignages, le spéléologue a régulièrement affirmé que pour une grande part sa passion lui est venue d'un solide et précoce intérêt pour la préhistoire. l'œuvre de Norbert Casteret, aussi ample que ses explorations et découvertes, est également celle d'un écrivain et d'un poète que la beauté des mondes enfouis émerveille et bouleverse. |
|||
|