
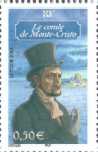
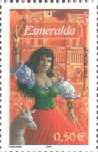

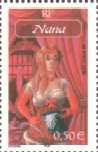
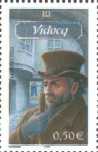
Monte-Cristo
|
Célébrités 2003 : Destinées Romanesques.
|
|||||
 |
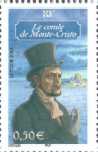 |
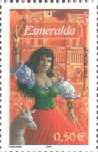 |
 |
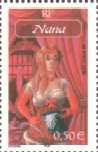 |
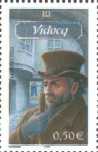 |
| Claudine |
Le Comte de Monte-Cristo |
Esméralda | Gavroche | Nana | Vidocq |
|
|
|||||
| Claudine | |||
       
|
|||
|
Colette prétendait rencontrer souvent Claudine. Celle-ci alors s'écriait: "Bonjour, mon Sosie", et Colette répondait: "Je ne suis pas votre Sosie. Vous êtes Claudine et je suis Colette. N'avez-vous point assez de ce malentendu qui nous accole l'une à l'autre, qui nous reflète l'une dans l'autre, qui nous masque l'une par l'autre?" L'équivoque fut pourtant provoquée par Colette elle-même quand elle créa Claudine, le jour où son époux Henry Gauthier-Villars, dit Willy, lui suggéra de mettre par écrit ses souvenirs d'écolière. À la publication de Claudine à l'école, en 1900, Willy s'en déclara l'auteur. Dans ce premier volume, la fillette en petit col blanc, baptisé plus tard par les couturiers "à la Claudine", grandit avec effronterie dans le bourg de Montigny-en-Fresnois, inspiré du Saint-Sauveur natal de Colette. Le caractère curieux et décidé de la petite Claudine plaît énormément aux lecteurs. Il faut continuer! décide Willy. Devenue le "nègre" de son époux, Colette écrit la totalité des Claudine, que Willy corrige, en suggérant des directions aguicheuses. Dans Claudine à Paris (1901) et Claudine en ménage (1902), l'héroïne se marie avec Renaud, un oncle plus âgé; elle découvre le plaisir dans les bras de son époux, et de Rézi, sa maîtresse. Claudine s'en va (1903) marque le temps de la déception. La Retraite sentimentale (1907) présente enfin une Claudine assagie, dédiée au souvenir de son époux décédé. Ce parcours amoureux remporta un triomphe, grâce au style frais et bondissant des récits. Si le ton de cette collection nous paraît un peu démodé aujourd'hui, la figure de Colette, que Claudine nous renvoie constamment en miroir, demeure le principal attrait de ces ouvrages, désormais signés des deux noms de Willy et de Colette. |
|||
|
| Le Comte de Monte-Cristo | |||
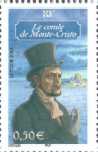 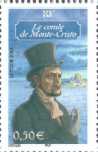 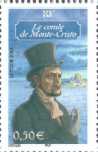 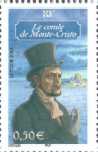 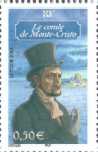 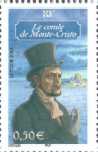 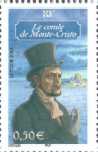 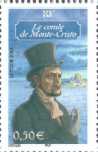
|
|||
|
Son visage a la pâleur des revenants. Le comte de Monte-Cristo sort en effet de la tombe. Injustement emprisonné,sans procès, au château d'If, l'homme qui s'appelle encore Edmond Dantès s'évade de sa geôle, au bout de quatorze ans, en prenant la place d'un mort, l'abbé Faria, son voisin de cellule. Jeté à la mer dans un sac qui devait contenir le cadavre, Dantès est recueilli par des marins. Enfin libre, le fugitif part à la recherche du trésor dont Faria lui a révélé l'existence en prison. Les indications, remises par le bon abbé avant sa mort, guident Dantès vers une fortune enfouie depuis le xv. siècle, sur l'île de Monte-Cristo, ce rocher inhabité, proche de l'île d'Elbe. Cette fabuleuse richesse, Dantès la met au service de sa vengeance. Celui qui se fait désormais appeler le comte de Monte-Cristo -et donne son titre à cet extraordinaire roman d'Alexandre Dumas père, publié en 1844-1846- réapparaît à Marseille, puis à Paris, où ceux qui l'ont trahi mènent grand train. Le comte ourdit une machination démoniaque, qui accule successivement ses ennemis à la ruine, à la folie, au meurtre, ou au suicide. Un à un, les criminels, qui lui ont dérobé sa jeunesse, sa fiancée (la belle Mercédès), et son père, mort de faim en l'absence de son fils unique, tombent sous les coups du justicier. D'une main, le comte distribue les châtiments; de l'autre, il récompense la bonté. Une fois vengé, son cœur s'apaise et Dantès retrouve, non sans remords, la douceur de vivre et d'aimer. Interprété à l'écran par Pierre Richard- Willm (1942), Louis Jourdan (1961) ou Gérard Depardieu (1998), ce personnage "qui, pareil à Satan, s'est cru un instant l'égal de Dieu" a inspiré de nombreuses suites ou variations, qui lui ont conféré, peu à peu, une dimension mythique. |
|||
|
| Esméralda | |||
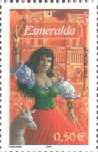 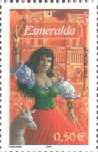 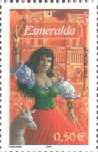 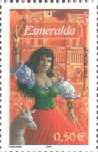 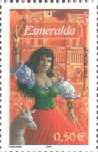 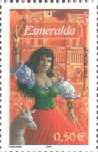 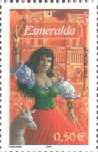 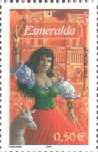
|
|||
|
Accompagnée par sa chèvre Djali, la belle Esmeralda danse sur le parvis de la cathédrale, pendant que Quasimodo, le bossu, est couronné "roi des fous". Parias tous deux, détestés et honnis -lui, pour sa difformité, elle, pour sa grâce surnaturelle et son appartenance au peuple des bohémiens-, la splendide Égyptienne et le monstrueux sonneur de cloches effeuillent leur destin tragique dans Notre-Dame de Paris de Victor Hugo (1831). Le drame s'enclenche lorsque Quasimodo tente d'enlever Esmeralda sur l'ordre du prêtre Frollo, son père adoptif, dévoré par un amour diabolique pour la jeune fille. Sauvée par Phœbus de Châteaupers, capitaine des archers du roi, Esmeralda s'éprend de son libérateur, tandis que Quasimodo est condamné au pilori. Exposé à la vindicte d'une foule haineuse, le bossu réclame à boire. Seule Esmeralda répond à sa demande et détache sa gourde. L'eau agit comme un élixir d'amour, qui lie à jamais Quasimodo à la belle Égyptienne. Quand celle-ci est condamnée pour sorcellerie, Quasimodo arrache la jeune fille à sa prison. Reprise par ses bourreaux, au moment où elle retrouve sa mère, grâce à un petit chausson conservé depuis l'enfance, dans une bourse ornée d'une émeraude de pacotille, Esmeralda est pendue, puis jetée au charnier de Montfaucon où Quasimodo vient mourir à son côté. Les abondantes adaptations confirmèrent, par la suite, le triomphe de cette fiction moyenâgeuse, dont les studios Walt Disney tirèrent Le Bossu de Notre-Dame. Au cinéma, Maureen Q'Hara et Charles Laughton, en 1939, puis Gina Lollobrigida et Anthony Quinn, en 1956, interprétèrent Esmeralda et Quasimodo. Le seul adaptateur peu chanceux fut en définitive Hugo lui-même, qui écrivit un opéra à la suite de son roman. Mis en musique par Louise Bertin, le livret d'Esmeralda fut joué en 1836, sans succès... |
|||
|
| Gavroche | |||
       
|
|||
|
Peu de héros de la littérature française sont aussi attachants que Gavroche, personnage espiègle et généreux des Misérables de Victor Hugo (1862). Chassé du foyer par ses parents, les épouvantables Thénardier, Gavroche fait de sa survie quotidienne une joyeuse aventure où chaque difficulté est l'occasion de déployer sa débrouillardise et sa générosité. Car celui, dont le nom est devenu synonyme de gamin de Paris, possède non seulement de l'astuce, mais aussi un cœur d'or: il cède volontiers son cache-nez aux mendiants grelottants, et prend sous son aile deux "mioches" égarés dans Paris. Princier, Gavroche partage son pain avec ces "momignards" sans logis et les héberge dans son palais: le ventre de l'éléphant de la Bastille, monument napoléonien aujourd'hui disparu, où Gavroche cohabite... avec les rats. Aux "mioches" stupéfaits, il apprend qu'on dit "la sorgue" pour la nuit, "morfiler" pour manger, et qu'une existence libre recèle des plaisirs infinis. Lors de l'émeute de juin 1832, Gavroche se bat naturellement pour la république et la liberté. Quand les munitions viennent à manquer aux insurgés de la barricade de la rue de la Chanvrerie, dans le quartier des Halles, Gavroche quitte son abri afin de récolter des cartouches sur les cadavres des gardes nationaux. l'ennemi lui tire dessus. Et après? Il chante, "l'enfant follet ", en avançant à découvert vers ses adversaires auxquels il adresse des pieds de nez: "Joie est mon caractère, / C'est la faute à Voltaire, / Misère est mon trousseau, / C'est la faute à Rousseau." Une balle touche Gavroche. Seulement blessé, il se redresse: "Je suis tombé par terre, / C'est la faute à Voltaire, / Le nez dans le ruisseau, / C'est la faute à... " Cette fois, Gavroche ne se relève pas. Il est mort, mais, dans nos cœurs, il chante pour l'éternité. |
|||
|
| Nana | |||
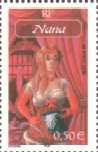 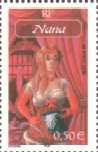 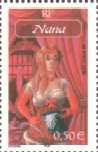 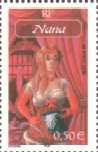 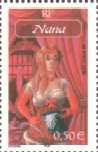 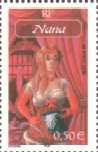 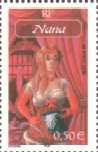 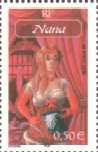
|
|||
|
Nana fait ses débuts en Vénus sur la scène des Variétés. Elle chante "comme une seringue", mais qu'importe! À la vue de ses cheveux blond-roux, et de sa fossette au menton, le tout-Paris s'enthousiasme. Nana est lancée! La beauté de Nana affole les hommes et les enchaîne à son corps de déesse, mais le prix à payer est à la mesure de la vénusté de la courtisane. À aimer Nana, les hommes perdent non seulement leur fortune mais aussi leur âme: "Un homme ruiné tombait de ses mains comme un fruit mûr, pour se pourrir à terre, de lui-même." Par Nana, fille de Gervaise Coupeau, s'opère l'anéantissement d'un monde. Les désirs qu'elle suscite révèlent la décadence d'une société à la moralité corrompue. Entretenue par le comte Muffat, chambellan de Napoléon III, et dévot déchiré entre sa peur de l'enfer et son amour pour Nana, la corruptrice règne en maîtresse absolue de l'immoralité. Cette cocotte impitoyable, décrite dans le neuvième roman de la série des Rougon-Macquart d'Émile Zola (1879-1880), agit comme "un ferment de destruction, [...] corrompant et désorganisant Paris, entre ses cuisses de neige ". À la déclaration de guerre de 1870, le masque de Vénus tombe. Nana meurt, défigurée par la petite vérole, tandis que le Second Empire s'écroule. Son vedettariat ne fait en réalité que commencer! En 1877, le peintre Édouard Manet immortalise Nana dans un tableau. Son histoire sera transposée au théâtre en 1881, avec la collaboration de Zola, puis au cinéma dès 1910. Suivront de multiples adaptations ressuscitant la légende: celle qui fut l'une des premières héroïnes débauchées prendra les traits de Catherine Hessling, dans un film de Jean Renoir, en 1926; de Martine Carol (Christian Jaque, 1954); d'Emmanuelle Seigner (Claude Miller, 1997); et de Lou Doillon (Édouard Molinaro, 2001). |
|||
|
| Vidocq | |||
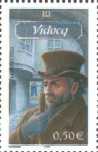 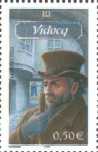 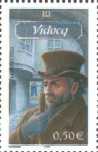 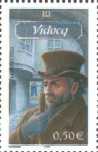 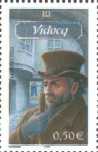 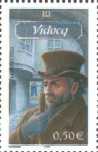 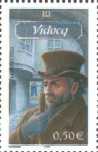 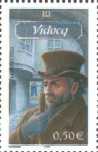
|
|||
|
La vie d'Eugène-François Vidocq (1775-1857), ancien bagnard devenu l'un des plus grands policiers de France, s'apparente à un véritable roman. Comme Balzac et Victor Hugo, qui s'inspireront de Vidocq pour créer les personnages de Vautrin, dans La Comédie humaine, et de Jean Valjean, dans Les Misérables, nous cédons à la fascination devant ce fils de boulanger, engagé dans l'armée française en 1791, qui passe à l'ennemi avec le général Dumouriez, en 1793; écume le nord de la France dans la fameuse "armée roulante", cette bande de faux militaires vivant d'abus et de rapines; et atterrit une première fois en prison, en 1795. Commence une longue série de fuites, de captures et d'incarcérations qui rendront Vidocq extrêmement célèbre. Le "roi de l'évasion" parvient même à s'échapper des bagnes de Brest et de Toulon! Quand il quitte la ville de Toulon, travesti en matelot, tandis qu'au bagne, l'alerte retentit, Vidocq a vingt-cinq ans et la ferme conviction que les pénitenciers transforment définitivement les détenus en criminels. Dans ses Mémoires (1828), il écrit: "Le condamné [...] ne connaît de loi que le bâton auquel ses bourreaux l'ont accoutumé." Le parcours du forçat évadé sera pourtant le contre-exemple de cette thèse. En 1809, Vidocq retourne sa veste et entre au service de la police. D'abord mouchard, il sera nommé chef de la Sûreté, en 1812. Devenu le Fregoli de la police, il mène ses enquêtes sur le terrain, à sa manière, déguisé en malfrat, en fort des halles, en général, ou... en religieuse. Aidé de collaborateurs recrutés dans les bagnes, Vidocq démasque les assassins sans jamais se dévoiler complètement. Si Vidocq a désormais, pour nous, les traits de Bernard Noël ou de Claude Brasseur, qui l'ont interprété sur le petit écran, il demeure à jamais un personnage énigmatique, aux mille visages. |
|||
|