



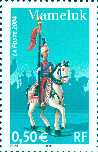
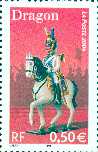
|
Célébrités 2004 : Napoléon 1er et la garde impériale.
|
|||||
 |
 |
 |
 |
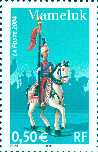 |
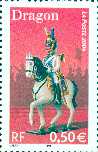 |
| Napoléon 1er | Artilleur à pied | Grenadier à pied | Chasseur à cheval | Mameluk | Dragon |
|
|
|||||
| Napoléon 1er | |||
       
|
|||
|
A la fin du Consulat, Napoléon ne revêt plus l'uniforme d'officier général, mais adopte l'habit de grenadier à pied de la garde ou celui de chasseur à cheval de la garde, avec les épaulettes de colonel. Sa coiffure est un chapeau qui n'a plus l'aspect réglementaire, ni par sa forme ni par ses attributs : ganse, cocarde et bouton. Avec ses uniformes, il porte l'épée et deux décorations : la Légion d'honneur et la couronne de fer. En campagne, il lui arrive de se vêtir d'une redingote grise, bleue ou verte. Napoléon a été initié à l'art équestre par monsieur d'Auvergne, écuyer en chef du Manège de l'École royale militaire. Il acquit avec l'enseignement, qu'il reçut à l'École, la pratique d'une équitation d'endurance plutôt que celle d'un art académique. C'est la raison pour laquelle Napoléon pouvait rester huit à dix heures à cheval et parcourir parfois quatre¬ vingt dix kilomètres en moins de quatre heures. Parmi les chevaux célèbres en sa possession, on retient le nom de trois d'entre eux pour en avoir conservé les traces : Jaffa, sa sépulture se trouve dans le parc du château de Glassenbury ; Marengo, son squelette est au National Army Museum à Londres ; Vizir, sa naturalisation est exposée au musée de l'Armée à Paris. |
|||
|
| Artilleur à pied | |||
       
|
|||
|
Le régiment d'artillerie à pied de la garde impériale est créé en 1808, à partir des compagnies d'artillerie de la vieille garde et, s'ajoute en 1809, celle de la jeune garde. L'uniforme a l'aspect général de celui des troupes à pied. L'habit, la veste et la culotte sont bleu foncé ; le collet, le passepoil des revers, les parements, les retroussis et les épaulettes sont écarlates, les guêtres noires ou blanches. L'artilleur de la vieille garde est coiffé d'un bonnet à poil pourvu d'une visière, avec un cordon et un plumet écarlates ; celui de la jeune garde, d'un schako. Le service de la pièce est assuré par quinze hommes, dont huit forment l'équipe de tir. Le tir est commandé par un officier tir, ses ordres sont transmis par un roulement de tambour. Autour de la pièce se trouvent un sous-officier ou un brigadier chargé de pointer la pièce grâce au volant de pointage et quatre artilleurs : un canonnier « boute-feu », qui enflamme la poudre d'amorce au moment de l'ordre de l'officier tir ; un canonnier « porte écouvillon et refouloir », qui nettoie le tube et le lave en puisant l'eau dans le seau suspendu au crochet de la roue droite ; avec le refouloir il tasse la charge de poudre et le boulet au fond du tube ; un canonnier « porte boulets » qui porte dans sa sacoche gargousses et boulets ; le canonnier « porte leviers », qui déplace la pièce latéralement selon les ordres du pointeur, à l'aide des leviers ; et le canonnier « débouche lumière » qui, à l'aide d'un poinçon, crève l'enveloppe de la charge de poudre et dépose dans « la lumière » (ouverture sur le dessus du canon par laquelle on communique le feu à la charge) de la poudre fine. |
|||
|
| Grenadier à pied | |||
       
|
|||
|
Le 15 mai 1804, le régiment de grenadiers à pied de la garde consulaire devient celui de la garde impériale. Entre 1804 et 1815, leur nombre augmente de un à deux en 1806, puis est réduit provisoirement à un seul en 1809, repasse à deux régiments en 1810 après avoir incorporé l'ex-régiment de la Garde royale hollandaise. En 1811, un nouveau régiment de contingent français est créé, portant ainsi le corps de grenadiers à pied à trois régiments jusqu'en 1813. À partir de cette date, il reste deux régiments de grenadiers à pied jusqu'à la fin de l'Empire. Il constitue le 1er corps de troupe à pied de la Garde impériale, devançant celui des chasseurs à pied. Le grenadier à pied est l'élite de l'élite des soldats de Napoléon. On le surnomme « le vieux grognard », en raison de son caractère bougon et grincheux. Ses officiers se recrutent parmi les plus braves, les plus respectables et les plus dévoués de leurs rangs. Les jours de batailles, les grenadiers revêtent la grande tenue : bonnet à poil avec plumet et cordon ; habit bleu foncé ; parements, retroussis et épaulettes écarlates ; revers, veste, culotte et guêtres blanches. C'est dans cette tenue, immobiles et l'arme au bras, qu'ils attendent les ultimes ordres de l'Empereur. |
|||
|
| Chasseur à cheval | |||
       
|
|||
|
Les guides du général Bonaparte sont créés pendant la campagne d'Égypte. L'effectif s'élève à une compagnie. Leur nombre, en constante augmentation, permet la création d'un régiment de chasseurs à cheval de la garde consulaire. À l'avènement de l'Empire, en 1804, le régiment formé de quatre escadrons est incorporé dans la garde impériale et fait partie des unités de la vieille garde. Il prend l'appellation de régiment de chasseurs à cheval de la garde impériale. Régiment préféré de Napoléon, dont il porte l'habit vert de petite tenue en campagne, il confie à son beau-fils, le prince Eugène de Beauharnais, le commandement du régiment de chasseurs à cheval de la garde impériale, devenant ainsi le premier colonel de cette prestigieuse unité de cavalerie. En campagne, ces chasseurs à cheval assurent le service d'honneur et la sécurité immédiate de l'Empereur. C'est avec l'uniforme le plus seyant de la cavalerie, coiffés du colback avec un cordon et un plumet, habillés à la hussarde aux couleurs vert et rouge, distinctive aurore, sabretache aux grandes armes impériales, qu'ils ne manqueront pas de se distinguer, pendant toutes les guerres de l'Empire, particulièrement à Austerlitz, Iéna, Wagram, Leipzig, Hanau et Champaubert, où ils décident, par de brillantes charges, de ces victoires. |
|||
|
| Mameluk | |||
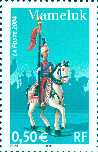 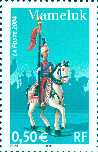 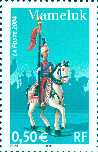 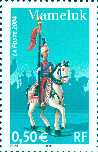 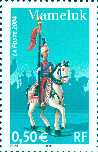 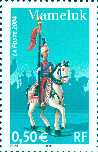 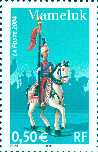 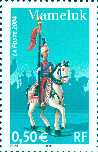
|
|||
|
Après la bataille des Pyramides, de nombreux mameluks rallient la cause du général Bonaparte. Portés à l'effectif d'une compagnie, ils sont intégrés dans la garde consulaire. En 1804, ils incorporent le régiment de chasseurs à cheval de la garde impériale et constituent l'escadron de mameluks. L'aspect de leur uniforme s'apparente à celui des guerriers ottomans aux couleurs vives et variées. L'habillement n'a jamais été défini par un texte précis. Il comprend un « cahouk » (coiffure turque) entouré d'un « shal » de mousseline surmonté d'une aigrette ; d'une longue tunique appelée « beniche » et, par-dessus, d'un court gilet sans manches nommé « yalek » ; d'un ample pantalon bouffant appelé « charoual », tenu par une large ceinture. Cet ensemble se complète par des bottes en cuir souple munies d'éperons arabes. Leurs armements sont des plus éclectiques : sabre à la turque, tromblon, pistolets, poignard, masse et hache d'armes. Le harnachement de selle et de tête est à l'orientale. Parmi ces cavaliers mameluks, on retient le nom de deux d'entre eux, Saint-Denis dit Ali qui remplace Roustan Raza en 1814, pour avoir été les deux mameluks d'ordonnance de l'Empereur. À l'image de leurs frères d'armes, les chasseurs à cheval de la garde, ils inscrivent leurs noms à Austerlitz, Pultusk, Wagram et pendant la campagne d'Espagne. |
|||
|
| Dragon | |||
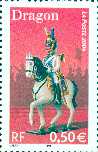 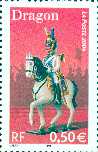 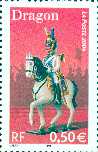 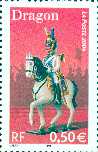 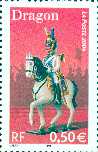 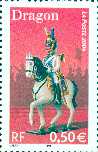 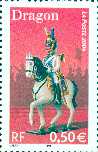 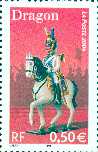
|
|||
|
Par décret du 15 avril 1806, l'Empereur Napoléon le forme un régiment de dragons dans sa garde impériale. Pour cela, il prélève 12 hommes ayant 10 ans de service, sur chacun des 30 régiments de dragons de la ligne. L'uniforme est proche de celui du régiment de grenadiers à cheval. L'habit de drap bleu est remplacé par celui de teinte vert foncé, le bonnet à poil par un casque à cimier doté d'une crinière, d'un marmouset, d'un plumet et d'un bandeau façon léopard. Le trompette est revêtu du même habit mais blanc avec revers, collet, parements et retroussis bleu céleste, couleur distinctive des trompettes de la vieille garde, et garni de passementerie d'or. La tenue se complète d'une culotte de peau, d'une paire de bottes de grosse cavalerie et d'une paire de gants à crispin. La trompette est dotée d'une banderole bleu céleste brodée, galonnée et frangée d'or. L'ensemble de cet uniforme compte parmi les plus élégants de la cavalerie de la garde impériale. De toutes les grandes batailles de l'Empire, l'histoire retiendra les charges héroïques des dragons de la garde à Eylau, Friedland, Wagram, Leipzig, Montmirail, Arcis-sur-Aube, Ligny et du drame de Waterloo. |
|||
|