Pays le plus visité au monde, la France, au cours du temps, a construit un patrimoine à la mesure de l'étonnante diversité de ses régions. Elles attirent et retiennent par le charme que dégage leur fidélité à un mode de vie traditionnel original et accueillant.
La Poste vient d'interroger les Français afin de connaître ce qui, selon eux, symbolise le mieux l'art de vivre de leurs régions. Ce voyage de découvertes offre des images simples, sans mondanités ni snobisme: elles ont le goût du vrai, de l'authentique. Elles montrent le réel attachement des Français aux produits du terroir élaborés avec un grand savoir-faire, aux plats régionaux transmis de génération en génération, aux objets, aux jeux... à toutes ces choses que les régions teintent souvent d'une couleur locale qui les marque et qu'elles conservent quand elles émigrent bien au-delà de leur lieu d'origine.
N'en est-il pas ainsi de la pétanque, art de vivre et spécialité du Midi, de Guignol, marionnette européenne qui fait partie du patrimoine lyonnais, ou de la porcelaine de Limoges, connue dans le monde entier? D'autres appartiennent au paysage, comme ces cabines de bain des plages qui s'égrènent du Nord-Pas-de-Calais à la Normandie en passant par la Picardie, derniers salons de bois où l'on "cause", ou ces cabanes de pêche aux grands filets carrés, installées sur les côtes de l'Atlantique, pour attendre le poisson. Il est des mots du vocabulaire de tous les jours qu'il suffit de prononcer pour évoquer des régions précises. Crêpe de froment ou de blé noir, cassoulet qui mitonne dans son récipient de terre cuite, camembert parti à la conquête du monde dans sa boîte ronde de bois déroulé, foie gras d'oie ou de canard gavé de maïs, champagne léger et grisant, paré de toute une symbolique...
Et toutes ces images si diverses dessinent, chacune à sa façon, cet art original de prendre le temps de profiter de tous les petits plaisirs de la vie, l'art de vivre des régions de France, qui demeure à jamais synonyme de convivialité.
    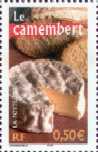 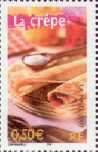     |

Alors qu’il se retrouve sans emploi après la Révolution, l’ancien canut Laurent Mourguet (1769-1844) décide de gagner sa vie autrement. Vers 1808, il fabrique une marionnette à son effigie et la met en scène à Lyon dans des spectacles populaires. Elle lui ressemble trait pour trait et ne tarde pas à faire parler d’elle. Tout à la fois impertinent, facétieux, rusé, débrouillard et roublard, Guignol est aussi naïf. Créé peu de temps avant lui, son ami et confident Gnafron ne le quitte pas. Guignol est souvent représenté avec son bâton, car on ne compte plus ses démêlés avec le gendarme et les coups de bâton qu’il lui administre.
A sa mort, Mourguet laisse derrière lui dix enfants et une forte tradition de marionnettes. Le flambeau des aventures de Guignol est repris à Lyon par d’autres marionnettistes à travers cafés et autres lieux publics. Avec sa redingote marron à boutons dorés, ses cheveux noirs ramassés en natte et son tricorne, Guignol n’épargne personne. Dans un parler régional, il se livre au divertissement public par la critique, la moquerie et d’information. Chez Guignol, les plus démunis sont bien souvent ceux qui s’en sortent le mieux.

Les cabines de bain sont le fruit de la pudeur et de la mer. Alignées en bord de mer, elles apparaissent pour la première fois en 1820 sur les plages du Nord, à Dieppe, motivées par l’émergence de la mode anglaise des bains de mer thérapeutiques. Les baigneurs en cure se changeaient dans une cabine à roue. Cette dernière était tractée jusqu’à la mer par un cheval robuste, mouvement qui permettait à un curiste de se glisser dans l’eau, à l’abri des regards.
Ce privilège ambulant était cependant réservé à une élite jusqu’à l’arrivée du chemin de fer qui a ouvert les bains de mer aux loisirs. La naissance du tourisme encourage dès lors le développement des stations balnéaires sur l’ensemble des côtes françaises. Les cabines fixes sont nées du désir de posséder sa propre cabine. A Deauville, leur construction est confiée à Charles Adda. Les 250 cabines de style romain, édifiées par l’architecte parisien, sont aujourd’hui classées au registre des Monuments historiques et se transmettent de génération en génération.

Quelques ingrédients de base sont nécessaires à la réussite d’une partie de pétanque. Le soleil, les amis, le chant des cigales, le pastis et bien entendu les boules. Les fragances méridionales du romarin, du thym, de la lavande ou du basilic viennent quant à elles agrémenter le jeu. C’est au cours d’une partie disputée en 1910 que ce jeu de boules est né à La Ciotat, près de Marseille. Souffrant de rhumatismes, Jules Le Noir s’est vu autoriser par son adversaire à mener la partie les pieds joints et sans se déplacer. D’où le nom de pétanque qui en provençal (ped tanca) signifie pieds joints. L’histoire de la pétanque commence ! Déjà dans les civilisations antiques, le jeu de boules était fort apprécié. Les Grecs s’en servaient pour éprouver leur force, tandis que les Romains en firent un jeu d’adresse et de détente, avant de l’introduire en France lors de la conquête des Gaules.
La règle du jeu tel qu’il est pratiqué aujourd’hui consiste à lancer la boule de métal au plus près du petit cochonnet en bois. Et pour y parvenir, précision, concentration, évaluation et convivialité sont de mise.

À l’embouchure de la Gironde, la pêche se pratique sur pilotis. Comme pour vivre la délicieuse magie de la pleine mer... sur le rivage. Un petit pont guide le pas du pêcheur vers une cabane de bois montée sur pilotis. Chaque cabane est surmontée d’un carrelet, ce grand filet carré tendu sur deux portions de cerceaux croisés attachés au bout d’une perche dont l’origine remonte à l’Antiquité. A marée haute, le filet est descendu dans l’eau. Le pêcheur jette l’appât au centre du carrelet et patiente. A l’arrivée du poisson, il remonte rapidement le filet à l’aide d’un treuil. Cette manière de pêcher est aujourd’hui moins pratiquée. Cependant, on compte encore 600 carrelets dans le département de Charente-Maritime. Ces avancées vers la mer, pontons de bois coiffés de cabanes font désormais partie intégrante du paysage charentais et nous offrent l’assurance de charmantes promenades en bord d’estuaire.
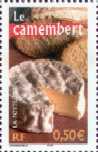
La France compte plus de 400 variétés de fromages. Mais c’est dans le tout petit village de Camembert (dans l’Orne), que naquit au crépuscule du Siècle des Lumières un symbole français qui rayonne à travers le monde. Au cœur même de cette Normandie qui a toujours su tirer profit du lait de ses vaches. Selon la légende, le camembert a vu le jour en 1790 par la grâce de Marie Harel, une fermière augeronne qui, durant la Révolution, aurait prêté refuge dans sa ferme à un prêtre réfractaire originaire de la Brie. Autre région du fromage ! En remerciement de son hospitalité, ce dernier lui aurait alors livré le secret de la fabrication du camembert. Un témoignage de reconnaissance qui deux siècles plus tard ravit encore le palais du gastronome. Trois semaines sont nécessaires pour transformer le lait cru frais de vaches normandes en ce fromage rond à la croûte affinée qui se déguste ferme, tendre ou coulant. En venant s’ajouter aux nombreuses spécialités qui font la renommée de la région, le camembert fait de la Normandie un somptueux banquet à ciel ouvert.
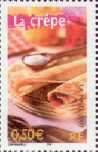
La Bretagne abrite derrière ses côtes déchirées une multitude de bienfaits gastronomiques. La traditionnelle crêpe bretonne est une spécialité appréciée de par le monde. Salée ou sucrée, simple et nourrissante, elle se prépare aisément. Encore faut-il avoir le coup de main pour la faire sauter ! Farine de froment, œufs et liquide (eau, lait ou bière) suffisent à sa préparation. La première recette écrite de crêpe remonte à 1390 mais on pense que les galettes - simple mélange de farine et d’eau - sont apparues vers 7000 avant Jésus Christ. Lorsqu’au XIIème siècle, les croisés rapportent d’Asie le sarrasin, ce blé noir trouve en la péninsule armoricaine une terre hospitalière. Devenue alimentation de base dans les campagnes, la galette de sarrasin est à un ingrédient près l’ancêtre de la crêpe de froment qui, elle, était plutôt réservée aux propriétaires terriens et aux habitants des villes.
Même si depuis 1872, date de l’arrivée du pain, la consommation de crêpes est réduite, nul n’est besoin d’attendre la chandeleur ou Mardi Gras pour en déguster.

Les vignobles de Champagne s’étendent fièrement sur cinq départements : l’Aube, l’Aisne, la Seine-et-Marne, la Haute-Marne et la Marne qui accueille la totalité des grands crus champenois. La magie champenoise tient à son sol tout à la fois crayeux et calcaire. Car la craie a l’art de restituer durant la nuit la chaleur du soleil accumulée dans la journée rendant ainsi la maturation du raisin plus savoureuse. 30.000 hectares de vignes s’étendent à perte de vue sur les trois grandes régions viticoles que sont la vallée de la Marne, la Côte des Blancs et la Montagne de Reims, ville hautement historique, puisque c’est là que Clovis 1er, roi des Francs, se convertit au catholicisme sans doute en 496.
Issu de trois cépages, un blanc (le Chardonnay) et deux rouges (Pinot noir et Pinot meunier), le Champagne est un vin mis au point par Dom Pérignon (1638-1705), alors moine de l’abbaye d’Hautvillers, près d’Epernay. Ce dernier développa la méthode champenoise de fermentation, prise de mousse en bouteille et bouchage au liège entouré d’un muselet. Rœderer, Heidsieck, Moët et autres Ruinart, enchantèrent sans peine la cour de Versailles avec ce breuvage à la mode qui, aujourd’hui encore, ravit invariablement les palais en fête.

Le cassoulet fait couler beaucoup d’encre ! Selon certains, il serait apparu après la découverte du Nouveau Monde d’où auraient été importés les haricots qui le composent. D’autres pensent qu’il serait né durant le siège de Castelnaudary (Aude) où le prévôt de la ville fit préparer un plat composé de toutes les victuailles disponibles sur place afin de nourrir les assiégés affamés. D’autres encore pensent que ce sont les arabes qui dans leurs bagages portèrent la fève blanche qu’ils avaient coutume de préparer avec le ragoût de mouton. Alors Christophe Colomb, guerre de cent ans ou conquêtes arabes ? Si l’origine du cassoulet est incertaine, sa recette ancestrale demeure quant à elle invariable.
Pour réussir un cassoulet digne de son Languedoc-Roussillon natal, il faut se munir de 30 % de viande, 70 % de haricots et d’une cassole, récipient en terre cuite auquel il doit son nom. C’est un plat populaire, consistant et familial, dont les saveurs ouvrent l’appétit vers d’autres richesses régionales tels les édifices d’art roman.

Blancheur, translucidité et délicatesse sont les trois vertus de la porcelaine. Son histoire débute en 1768 lorsque des gisements de kaolin sont découverts à Saint-Yriex-la-Perche, une localité voisine de Limoges. Grande découverte s’il en est puisque cette variété d’argile - déjà utilisée en Chine sous la dynastie Tang (618-907) - présente la particularité de rester blanche après la cuisson. Le kaolin était donc le seul élément qui manquait pour offrir à la porcelaine sa blancheur, sa dureté et sa translucidité. Il entre à 50 % dans la composition de la porcelaine, le reste étant du feldspath et du quartz. Turgot, alors intendant du Limousin, ouvre en 1771 la première manufacture du Limousin (seconde manufacture de porcelaine dure après Sèvres) qui devient une source de richesse pour la région. Une trentaine de manufactures verront le jour dès 1830. La qualité des kaolins conjuguée à l’habileté technique des artisans ont fait de la vaisselle de table en porcelaine de Limoges une exception française. Aujourd’hui encore, porcelaine rime avec Limoges.

Tout a commencé lorsque des oies sauvages vinrent à passer un hiver du IIIème millénaire avant Jésus-Christ dans les marais du delta du Nil. Stupéfaits par la grosseur et la saveur du foie de ces oies, les Egyptiens ne tardèrent pas à comprendre qu’elles avaient accumulé de la nourriture (essentiellement des figues) pour survivre lors des migrations. Il ne leur restait alors plus qu’à reproduire des gestes de suralimentation pour déguster une nouvelle fois cette chair grasse et tendre. La consommation de foie gras disparaît brutalement à la chute de l’Empire romain pour réapparaître dans le Béarn au XIVème siècle.
L’apport du maïs par Christophe Colomb ajouté au savoir-faire des Juifs d’Europe centrale et des fermiers du Sud-Ouest de la France relancent définitivement l’élevage et l’engraissement des oies et canards. Si bien qu’aujourd’hui les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées produisent 90 % du fois gras. Après trois semaines d’engraissement au grain de maïs (et non plus de figues) pour les oies et deux semaines pour les canetons, le foie gras devient le convive des tables gastronomiques.
| Reproduction interdite © La Poste / © Timbres magazine 2003 |