Pour "la France à voir", second thème de l'opération "Portraits de régions", événement philatélique de l'année 2003, les Français ont choisi les sites naturels remarquables et les monuments célèbres ou méconnus qui, à leur avis, symbolisent le mieux le patrimoine de leurs régions. Le résultat ? Dix timbres qui constituent les hauts lieux, trésors et paysages d'un voyage imaginaire sillonnant une France faite de contrastes et de nuances, modelée par une heureuse collaboration de la Nature et de l'Homme.
De la pointe du Raz "sanctuaire du monde celtique", site le plus saisissant de la côte atlantique, au mont Blanc, le géant des Alpes... De Paris dont l'arc de triomphe de l'Étoile reste le lieu où s'investissent les sentiments patriotiques, à la Loire tourangelle aux châteaux incomparables dont le divin Chenonceau... Des toits de tuiles vernissées multicolores des hospices de Beaune flambant sous le soleil, aux tours rondes du cap Corse édifiées au XVIème siècle par les Génois... et au prodigieux témoignage de l'architecture romaine qu'est le pont du Gard... Rien ne manque à cette France si diverse et changeante, destination touristique mondiale numéro 1, où l'histoire et les bâtisseurs ont laissé les traces de leur passage. Et, à côté de ces trésors architecturaux célèbres, il y a la richesse anonyme des maisons traditionnelles. Expressions spontanées d'un terroir, elles révèlent le rapport de l'homme au climat, aux impératifs naturels, à la tradition locale.
Murs de pierre revêtus d'un mortier granité, épais volets de bois, tuiles "canal" à la romaine sur un toit à pente faible: c'est le mas provençal qui se défend contre le mistral. Toit débordant, murs blancs, poutres et vo1ets rouges, c'est l'etche, la maison basque. Enfin son toit très incliné, son colombage bien particulier, balustres et portes sculptées donnent sa silhouette originale à la maison alsacienne en pans de bois.
Par un parcours de découvertes dans l'ambiance subtile des régions, c'est aussi leur France "côté cœur" que les Français donnent à voir.
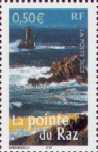  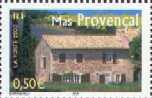  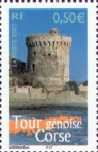 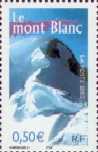 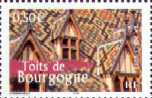   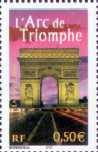 |
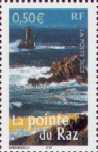
Secourez-moi, Grand Dieu, à la pointe du Raz, mon vaisseau est si petit et la mer si grande !, les marins redoutent depuis toujours cette pointe de terre située au bout mythique du monde. C’est au cœur des côtes déchirées de Bretagne, à l’extrémité occidentale du Finistère que la redoutable Pointe du Raz fait rage. Située au nord de la Cornouaille, elle fait face à l’île de Sein. Dunes, faune et flore ont semble-t-il seules su s’imposer et apprivoiser ce coin de paradis infernal. Au cap Sizun, les dunes fragiles se réfugient dans les creux abrités de la côté à falaise, tandis qu’au Loc’h des plantes rares tel le liseron ou le gaillet des sables poussent sans mesure et que le Guépier d’Europe et la Bergeronnette printanière volent sans crainte. La Poste émet pour la seconde fois un timbre à l’effigie de la Pointe du Raz, le premier datant de 1946.

A une trentaine de kilomètres à l’est de Tours trône le château de Chenonceau, véritable fleuron de la Renaissance. Fierté du Val de Loire, c’est à six femmes qu’il doit tous ses attraits. Ces dernières présidèrent en effet à sa construction et imposèrent tour à tour leur style. Lorsque Thomas Bohier, alors général des Finances et mari de Catherine Briçonnet, acquit les lieux en 1513, ce n’était qu’une bâtisse moyenâgeuse qu’il rasa à l’exception du donjon. Le reste n’était plus qu’une affaire de femmes. Cette dernière qui prend la direction des travaux innove en installant un escalier à rampe droite.
En 1547, Henri II alors marié à Catherine de Médicis offre par amour le château à Diane de Poitiers, sa favorite. Laquelle suggère de jeter un pont sur le Cher et de créer des parterres à l’italienne. Une fois veuve, Catherine de Médicis récupère le château de sa rivale et en fait un lieu de réceptions incessantes. En 1589, Louise de Lorraine s’y retire calmement. En 1733, le château est racheté par le fermier général Dupin. Son épouse aime y faire salon. C’est grâce à cette femme que le château est sauvé pendant la révolution. Le jardin à la française bien ordonné invite à entrer au château car Chenonceau cultive également sa beauté intérieure. Une collection de mobilier Renaissance accompagne un ensemble de tapisseries des XVIème et XVIIème siècles. Le Primatice, le Corrège, Rubens, Le Tintoret, Rigaud, Nattier, Van Loo sont autant de convives permanents du château au travers de leurs toiles de maître. Le château de Chenonceau est à l’honneur pour la troisième fois puisqu’en 1942 deux timbres avaient déjà été émis à son sujet.
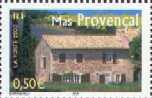
En Provence la nature offre des attraits naturels que l’on retrouve dans les maisons. Ainsi la pierre, la chaux, le calcaire (pour les sols), l’argile (pour les tuiles) et le sable qui proviennent de la région font partie des matériaux utilisés pour la construction du mas provençal. Demeure des petits propriétaires aisés, il est le lieu de l’exploitation familiale. Installé en plaine, cet habitat typiquement provençal est en général divisé en deux niveaux. Le rez-de-chaussée abrite la pièce à vivre, la salle et les dépendances agricoles tandis que le premier étage accueille les chambres et le grenier. La toiture du mas est faite de tuiles rondes de couleur rouge. Elle comporte soit un seul pan (en appentis) soit deux pans (en bâtière). Le mas est par définition une maison qui de par la configuration même de sa construction permet d’évoluer au gré des besoins de la famille. La façade exposée au sud comporte des murs latéraux qui favorisent l’ajout de nouveaux bâtiments au fur et à mesure que la famille s’agrandit.

La construction à colombage usitée du XVème au XIXème siècle est l’une des caractéristiques de la maison alsacienne. Le colombage est l’entrecroisement d’une armature de poutres de chêne ou de châtaignier qui rejoint une sorte de treillis de branchages de noisetier sur lequel est appliqué un torchis constitué de terre, d’argile et de paille hachée. Lequel torchis est ensuite recouvert d’un crépi blanc ou ocre. Les toits interminables sont cuirassés de tuiles en “queue de castor”. Trésor insoupçonnable de l’extérieur, la maison alsacienne est souvent dotée d’une cour intérieure étayée au premier étage d’une galerie en bois. Hangar, grange, étable et quelques pièces spécifiques comme le fumoir à viande, la distillerie, la cave à vin ou la cave à pommes de terre... viennent agrémenter l’effet de surprise.
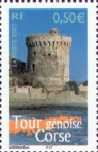
C’est pour se protéger des invasions multiples orchestrées par les pirates barbaresques entre les XVIème et XVIIème siècles que le littoral corse s’est doté de tours de guet appelées tours génoises. Erigées souvent en granit gris, elles sont hautes de 12 à 17 mètres. En effet, s’armer de bateaux pour défendre l’île - contre les enlèvements menés par la mer, les disparitions de troupeaux ou de navires - devenait trop coûteux. Témoins muets d’un autre temps, elles doivent leur nom à la ville de Gènes ; puisque c’est à l’initiative de la République de Gènes et de l’Office Saint Georges que ces tours ont été construites. Près d’une centaine de tours génoises marquées par le temps et les assauts guerriers subsistent encore sur le littoral corse qui toujours gardent un œil sur la mer.
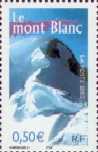
Tout comme la Pointe du Raz en Bretagne, le Mont-Blanc est une pure merveille créée par Dame Nature à 10 km au sud de Chamonix. Dressé à 4.808 mètres d’altitude, le Mont-Blanc est aussi le point culminant de l’Europe. Situé en Haute Savoie, dans les Alpes françaises, il fut atteint pour la première fois en 1786 par un guide J. Balmat et le docteur Pacard. Le géologue et physicien suisse H. B. de Saussure effectua l’année suivante la seconde ascension. Un premier timbre à l’effigie de la montagne mythique a été émis en 1964. Suivi d’un second émis en 1986 à l’occasion du bicentenaire de la première ascension du Mont-Blanc.
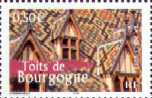
La Bourgogne est appréciée pour sa vigne, ses clochers mais aussi ses toits de tuiles vernissées qui s’inspirent des couleurs de la vigne en automne et recouvrent les édifices religieux comme l’habitat traditionnel de l’époque des Ducs de Bourgogne. Sans doute originaire de Bourgogne, la tuile vernissée apparaît en Franche-Comté au XVIIIème siècle.
Recouverte tout d’abord d’une glaçure à base de plomb, chaque tuile prendra une couleur différente après cuisson. Les sels de plomb donnent un vernis qui fond après la deuxième cuisson et donne cet aspect glacé lorsqu’il est appliqué sur les tuiles de terre cuite. Le mélange avec d’autres sels minéraux donne des teintes tel que le jaune, orange, vert, rouge et brun foncé. La disposition des tuiles donne des motifs de toiture différents. Le chevron, la trame losangée, les bandes horizontales et les fleurettes. Aujourd’hui marquées du seul nom de la tuilerie et de l’année, les tuiles arboraient jadis des poèmes, des éloges à Dieu ou même des injures.

Au Pays Basque tout tourne autour de la maison. Le terme qui la désigne “Etchea” est un symbole fort dans l’organisation sociale et l’activité rurale. Afin de désigner quelqu’un, on fait référence à sa maison qui elle-même se distingue en se référant à une montagne, un rocher, un point d’eau ou une forêt ou tout endroit caractéristique. Tous les liens qui unissent les familles convergent vers l’etchea. A tel point que bien souvent les habitants se connaissent mieux sous le nom de leur maison que sous leur réel patronyme. Il existe 3 types de maisons : le type Souletin caractérisé par une disposition en largeur et une toiture à quatre pans recouverts d’ardoises ; le type Bas-Navarraise caractérisé par l’usage de la pierre de grès rose et rouge. Au dessus de la porte d’entrée, le nom de la famille qui y réside et la date de construction est richement sculpté ; et enfin le type Labourdin qui est le plus symbolique de la maison basque. Il est caractérisé par des murs blanchis à la chaux, un toit en tuiles romaines et des pans de bois apparents de couleur rouge sang de bœuf.

A une trentaine de kilomètres de Nîmes, le pont du Gard enjambe une rivière longue de 133 km. Affluent du Rhône, ladite rivière est formée de la réunion des torrents d’Anduze et d’Alès. Construit vers l’an 50 de notre ère, le pont du Gard correspond à une partie de l’aqueduc construit pour transporter sur 50 kilomètres - entre Uzès et Nîmes - l’eau de la source d’Eure. Pont aqueduc romain long de 273 mètres, haut de 49 m et composé de trois rangs d’arcades, il fonctionnait encore au début du Vème siècle. Aujourd’hui haut lieu touristique, son abandon date du courant du VIème et VIIème siècles. Depuis 1985, il est classé au Patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. Un premier timbre le représentant a été émis en 1929.
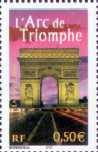
Avec ses 50 mètres de haut et ses 45 de large, l’Arc de Triomphe s’est taillé une place de roi à Paris. Il trône au centre de la place Charles-de-Gaulle face aux douzes avenues qui rayonnent telle une étoile comme pour converger toutes jalousement vers le monument. Lequel doit son architecture de style néo-classique aux plans de J. F. Chalgrin modifiés par Goust et Percier. Erigé sur ordre de Napoléon 1er en 1806, il fut inauguré en 1836. Et depuis 1920, la pierre tombale du Soldat Inconnu n’a de cesse de s’enflammer sous sa grande arcade. Presque aussi célèbre que la tour Eiffel qui fut inaugurée 53 ans plus tard, l’Arc de Triomphe est le monument le plus représenté en timbres. Un timbre en 1931, un autre en 1938, une série de 10 timbres en 1944, une autre en 1945. En 1917/18 et en 1936, trois timbres ont représenté ses hauts-reliefs ainsi que Le Départ des Volontaires (mieux connu sous le nom de La Marseillaise), cette sculpture de François Rude (1784-1855) qui figure sur l’un des pieds droits de l’Arc.
| Reproduction interdite © La Poste / Timbres magazine 2003 |