Ce nouveau bloc de la série « Portraits de Régions » nous offre une fois encore le plaisir de découvrir ou de retrouver la variété et l'originalité des ressources, des lieux, des modes de vie, des coutumes et des jeux de ce « vieux pays de France » qui a généré une mosaïque de régions, de terroirs aux mille et une richesses possédant le merveilleux pouvoir de donner du goût à la vie. « Cette série " La France à vivre " permet, dit Françoise Eslinger, de timbrifier des sujets qui ne le seraient pas isolément… »
L'émotion est devenue un moteur essentiel de la consommation et notamment dans le domaine alimentaire. Les recettes issues du patrimoine culinaire régional ont le vent en poupe. Le « comme autrefois » évoque le bien-être et rassure.Ainsi, les timbres images de ce bloc : bouillabaisse, choucroute, rillettes, cantal, canne à sucre côtoient avec bonheur guinguettes, pelote basque, P'tit-Quinquin, joutes nautiques et horloge comtoise, nous invitant tous ensemble à reconnaître que « la France est une réussite » et qu'elle mérite qu'on la savoure de bien différentes façons.
  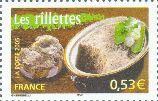   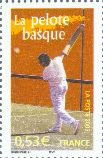 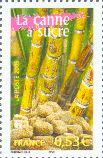   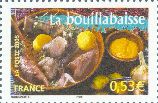 |

C'est à Lille que se dresse la statue qui illustre la berceuse du P'tit Quinquin « canchon dormoire » d'Alexandre Desrousseaux, chansonnier et employé municipal lillois. Créée en 1853 - elle a fêté ses 150 ans l'an passé - écrite en patois lillois, elle est devenue l'hymne des gens du Nord. « Dors min p'tit Quinquin min p'tit pouchin min gros rogin Te m'fras du chagrin si te ne dors point ch'qu'à d'main … »

Les joutes nautiques font partie des sports les plus anciens. Elles se pratiquent dans de nombreuses régions de France et attirent un nombreux public. Il s'agit de mettre l'adversaire à l'eau, de le « baigner » à l'aide d'une perche en bois, sans commettre de fautes. Le jouteur, installé sur la plate-forme arrière du bateau, jambe gauche vers l'avant, tient sa lance des deux mains et doit la planter au centre d'un plastron, bouclier de bois couvrant la poitrine de l'adversaire. On joute à la lyonnaise, la givordine, la parisienne, la languedocienne, la provençale, l'alsacienne.
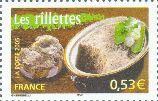
Préparées deux fois l'an, quand, en Indreet-Loire, on tuait le cochon, les rillettes restèrent longtemps des préparations domestiques destinées à conserver la viande de porc. Le mot « rillettes » apparaît en 1845 dans un dictionnaire, mais Rabelais le Tourangeau, en 1546, l'utilise dans son Tiers Livre pour désigner des morceaux de porcs cuits que l'on offre à ses voisins comme friandises… Ce n'est qu'en 1865 que les rillettes sont commercialisées par les charcutiers. Rabelais puis, plus tard, Balzac leur firent l'honneur de leurs écrits. Devenues sarthoises, elles ont donné naissance à des recettes variées appréciées dans toute la France.

C'est un hommage au savoir-faire séculaire des artisans du Jura, à leur tradition horlogère que nous offre la Comtoise, horloge de parquet du pays de Franche-Comté. Sa corniche est parfois en chapeau de gendarme, son cadran en émail, en faience ou en laiton. Sa caisse gainée en sapin est violonée, peinte et décorée à la main suivant une technique particulière de peinture gravée.

Pâte fine, couleur ivoire, goût de lait et de fruit, fine saveur de noisette : c'est le doyen des fromages, fabriqué pour constituer une réserve de nourriture toujours disponible. Fromage d'Auvergne, fabriqué exclusivement au lait de vache emprésuré, il appartient à la catégorie des pâtes pressées non cuites. Il porte le nom du département du Cantal et a obtenu l'AOC Cantal en février 1980. Il se déguste jeune (1 mois d'affinage), entre-deux (2 à 6 mois d'affinage) ou vieux (plus de six mois d'affinage).
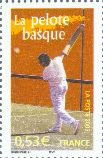
On dit que le claquement des pelotes rythme la vie du pays Basque. Il n'y a pas de village qui n'ait son fronton. Partout où il y a des Basques, on joue à la pelote, un jeu splendide qui libère le double instinct du Basque : son goût de la lutte et du pari. La balle dite « pelote » est constituée d'un noyau de caoutchouc dur, de la grosseur d'une bille d'écolier, sur lequel sont enroulés du coton et de la laine. Le tout est recouvert de peau de chien inextensible et indéformable.
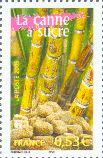
La canne, ce roseau de la grande famille des Graminées, dont les tiges renferment un jus sucré, est cultivée depuis la plus haute antiquité en Nouvelle-Guinée. Les Croisés feront connaître le sucre à la population européenne. Avec la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb, tous les pays colonisés se couvrent de canne à sucre. En 1789, la France occupe, en Europe, la première place dans le commerce et le raffinage du sucre. La canne, la plus importante production agricole de la planète, a rattrapé la première place que lui prit, un temps, sa grande rivale, la betterave sucrière.

Bords de Marne, canots, tonnelles, terrasses, airs d'accordéon, petit vin blanc : ce sont les guinguettes, lieux de plaisir où « le petit peuple » se rendait dimanches et fêtes. Leur histoire et leur nom - elles ne sont d'abord que des débits de boissons - sont liés au vin produit autour de Paris : le guinguet ou ginget. On y dégustait de la friture, on y dansait, on profitait de tous les plaisirs nautiques.
Muses des écrivains, des peintres, des musiciens et des cinéastes, l'âge d'or des guinguettes aura duré près d'un siècle mais l'automobile a précipité leur déclin. Cependant, les fameuses guinguettes de Nogent et de Joinville se sont installées dans la mémoire collective.

On raconte que les milliers de travailleurs infatigables qui bâtirent la Grande Mutaille de Chine se nourrissaient de choucroute : il s'agissait de choux fetmentés dans du vin. Elle arriva en Europe Centrale avec les invasions barbares pour parvenir en Alsace où elle subit, au XVème siècle, la métamorphose du chou saumuré en choucroute. C'est ainsi que le meilleur chou d'Alsace, le quintal, découpé en fines lamelles, est devenu la choucroute gastronomique garnie qui, accompagnée de lard fumé, de jambonneau, de saucisses de Morteau, de Montbéliard, de Francfort et de Strasbourg - sans oublier la pomme de terre : la rate, de préférence - s'est propagée à travers la France, associée souvent à une idée de fête.
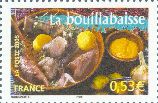
La soupe de poissons la plus célèbre de France, c'est la bouillabaisse. La bouillabaisse de Marseille. L'origine de son nom viendrait d'une vieille expression provençale : « Quand ça bouille, tu baisses » (sous entendu le feu de cuisson). A l'origine, sorte de bouillon de poissons vite préparé au retour de la pêche, et versé sur des croûtons de pain rassis frottés d'ail, la recette de cette soupe des pêcheurs a été améliorée pour devenir un « plat fin et subtil ». Une charte de la bouillabaisse de Marseille a été établie en 1980 indiquant les espèces de poissons à utiliser. Poissons qui doivent se trouver entiers sur le plat et être découpés devant le consommateur. La célèbre rouille et les croûtons frottés à l'ail en sont les inséparables compagnons.
| Reproduction interdite © La Poste 2005 - Timbres magazine 03/2005 |