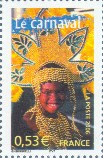  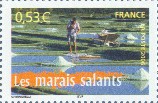 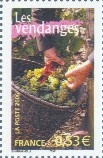 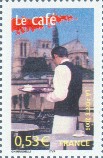    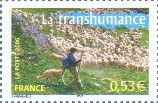  |
Dans cette nouvelle série de "La France à vivre", les timbres continuent leur découverte de l'Hexagone, du Nord au Sud, d'Est en Ouest, au fil d'une longue escapade. Ils pénètrent au cœur des régions, prennent le temps de s'arrêter, renouent les fils de la tradition, et, retrouvant l'art de vivre des pays de France, ils parlent avec leurs voix.
Si le timbre tient à se "perdre" dans les hortillonnages de la vallée de la Somme, ces jardins maraîchers cernés par de petits canaux où circulent les bateaux à fond plat, c'est pour dire que la France est belle, belle aussi hors des sentiers battus, et qu'elle foisonne de jardins secrets. Il en va de même quand il s'attarde avec les sauniers, dans le dédale des bassins des marais salants des îles de Ré et de Noirmoutier, pour récolter l'"or blanc", cette fleur de sel qu'on venait jadis chercher du bout du monde! Au printemps, quand par les routes et les sentiers de montagne, il monte avec les troupeaux rejoindre les verts pâturages pour y passer l'été, c'est qu'il tient à rappeler l'ancestrale tradition de la transhumance. Se plaît-il à faire un clin d'œil à celle de nos vacances d'été? Le voici retrouvant le goût du somptueux fromage qui a pris le nom de Roquefort, une ville de l'Aveyron, et reste sans contredit le premier fromage d'Europe, et celui du beurre, saveur de noisette, matière grasse la plus populaire du monde dont la France est le premier producteur européen. Il nous offre les fruits de la cueillette: la mirabelle si "belle à voir", fruit emblématique de la gastronomie lorraine, dont les fêtes attirent, chaque année, des milliers de visiteurs, et l'olive, symbole de la Provence, qui, pour chaque terroir, offre une huile aux mille et une saveurs rares et délicates. Pour nous parler de convivialité, pour nous montrer l'art et la manière de la cultiver, le timbre nous conduit au café parisien, petit théâtre où quotidiennement on refait le monde ou bien, quand vient le temps des vendanges, il retrouve sécateurs en acier, cuves, tonneaux et pressoirs, casse-croûte et chansons... Et pourrait-il manquer la symphonie de couleurs, les danses et les chansons du carnaval des Antilles, manifestation la plus populaire de toute la Caraïbe?
Les timbres donnent du goût à notre vie. Avec eux, on se sent partout chez soi en France!
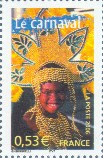
Du dernier dimanche de l'Épiphanie au mercredi des Cendres, dans la frénésie et la joie et une symphonie de couleurs, avec ses concours de costumes, de danses et de chansons, le Carnaval est assurément la fête la plus populaire de toutes les Antilles.
Introduit en Martinique à Saint-Pierre par les Français catholiques du XVIIIème siècle, c'est seulement après l'abolition de l'esclavage en 1848 que le carnaval se démocratise et acquiert un cachet particulier grâce à l'influence des anciens esclaves qui ont enrichi cette fête de leurs croyances et de leurs instruments de musique : tambour, cha-cha, ti-bois…
Aujourd'hui, « Vaval », le roi du Carnaval (mannequin à l'effigie d'un politicien, d'un personnage connu ou d'une institution) est promené dans les rues en tête d'une foule en liesse. A ses cotés défilent les reines du Carnaval. Le lundi gras est le jour du mariage burlesque. Le Mardi gras est marqué par les défilés des diables rouges. Le mercredi des Cendres est réservé aux joyeuses pleureuses en habits noirs et blancs (les diablesses). Le Carnaval se meurt et l'on brûle Vaval à la tombée de la nuit.

Elle est le fruit emblématique de la gastronomie lorraine - cette région possède la plus forte densité de mirabelliers au monde et fournit 70% de la production mondiale. « Le mirabellier est à la Lorraine ce que l'olivier est à la Provence. » Son nom vient du latin et signifie « belle à voir ». La mirabelle est le premier fruit (avec la poire et la pomme de Savoie) dont le nom et la qualité sont protégés au niveau européen par une Indication Géographique de Provenance (IGP). Chaque année, les fêtes de la Mirabelle qui se déroulent à Metz, à la fin du mois d'août, sont l'occasion de grandes festivités, elles attirent, tous les ans, depuis 1947, des milliers de visiteurs.
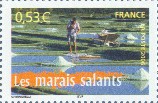
Les marais salants ou salines sont des bassins artificiels en bord de mer. L'eau de mer y circule de compartiment en compartiment, soumise à une forte évaporation permettant de récolter le sel marin. Le paludier, pieds nus, ramasse d'abord la « fleur de sel », « l'or blanc » que jadis on venait chercher du bout du monde, petits cristaux flottant à la surface de l'eau. Puis il ratisse inlassablement l'eau saumâtre pour récolter le gros sel et l'accumuler en tas.
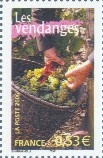
Les vendanges ne durent que quelques jours. Chacune d'elles est une aventure… Elles vont déterminer la qualité de tout un cru, de toute une année. Elles offrent la matière première : le raisin. Voici une vieille recette d'une bonne vendange bourguignonne. « Prenez une bonne équipe, quelques jeunes vendangeuses et deux, trois costauds pour porter, n'oubliez ni les sécateurs ni le vin blanc pour les pauses, pensez à louer une camionnette avec une roue de secours, ayez suffisamment de fûts lorsque l'on presse le blanc, ayez un chef et des sous-chefs, cuisinez un bon couscous pour la pause, et espérez qu'il ne pleuve pas. »
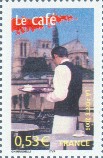
Le café français représente un certain art de vivre, il est un lieu de convivialité. Certains cafés parisiens sont célèbres par leur histoire ou par leur fréquentation, d'autres sont plus obscurs, mais tous restent de véritables petits théâtres où, quotidiennement, on refait le monde. C'est en 1686 qu'un jeune Italien Francesco Procopio Dei Coltelli, ouvre rue des Fossés-Saint-Germain un établissement d'un genre nouveau où l'on sert une boisson qui commence à faire fureur à la cour de Louis XIV, le café. « Le Procope » deviendra vite le premier café littéraire français, le rendez-vous des hommes politiques. « Le café de Flore », boulevard Saint-Germain, créé à la fin du Second Empire, recevra les célébrités des Arts et des Lettres. « Les Deux Magots », café de Verlaine, de Rimbaud et des surréalistes, emprunte son nom aux deux statues chinoises qui servaient d'enseigne au magasin de nouveautés qui occupait les lieux auparavant.

Roquefort : un nom de ville devenu fromage. On en fabrique plus de 17 tonnes par an. Jules César en parlait déjà dans son Commentaire sur la guerre des Gaules ! Il demeure l'un des plus anciens et des plus célèbres fromages. Il est fabriqué exclusivement à partir de lait de brebis, cru et entier ensemencé par le Penicillium roqueforti. Il restera cinq mois dans une cave naturelle d'affinage.
C'est un fromage à pâte persillée, en forme de cylindre d'une dizaine de centimètres d'épaisseur et dont le poids varie entre 2,5 et 2,9 kg. Diderot écrivait dans l'Encyclopédie qu'il était sans contredit le premier fromage de l'Europe. Dès le VIIIème siècle, le Roquefort est cité dans de nombreux actes, donations, rentes, et autres. Concernant le Rouergue. Charlemagne en avait fait son fromage favori. En 1666, un arrêt du Parlement de Toulouse concède aux habitants de Roquefort « le monopole de l'affinage du fromage tel qu'il est pratiqué de temps immémorial dans les grottes dudit village ». Malgré la Révolution, les privilèges accordés à Roquefort sont maintenus par la Convention qui décide que « ne sera Roquefort que ce qui sortira des caves »… En effet, c'est là que s'accomplit ce « miracle » de la nature…

L'histoire de l'olivier est indissociable de celle du Bassin méditerranéen. La plus ancienne mention écrite d'un procédé d'extraction de l'huile d'olive figure sur une tablette en argile de 2500 avant J.C., contemporaine du règne du mythique roi Minos, et retrouvée sur L'île de Crète. Il semble d'ailleurs que ce soient les Crétois qui aient introduit l'huile d'olive en Egypte. Les Grecs sont à l'origine de l'arrivée de l'olivier dans la péninsule Italienne, aux alentours de 800 avant J.C. Mais ce sont les négociants et marins phéniciens qui ont joué le rôle le plus décisif pour la propagation de l'arbre et de son huile dans les pays du pourtour méditerranéen. Un olivier peut théoriquement produire entre 15 et 60 kilos d'olives. Mais seulement une année sur deux.

C'est avec la crème de lait de vache que l'on fait du beurre, et cela depuis des siècles. La France en est le premier producteur européen. Sa valeur symbolique est attestée dans la bible ou il apparaît comme un témoignage d'accueil et d'affection.
Ce sont des peuples venus du nord et de l'est qui semblent l'avoir introduit en Gaule. Au XVIIIème siècle, Mme de Sévigné en vante la qualité. Dans son Encyclopédie, Diderot parle de sa fabrication, donne des conseils pour sa conservation et évoque son histoire: « Le beurre se fait en Barbarie en mettant le lait ou la crème dans une peau de bouc, suspendue d'un côté à l'autre de la tente, et en le battant des deux côtés uniformément. Ce n'a été que tard que les Grecs ont eu connaissance du beurre : Les Romains ne se servaient du beurre qu'en remède, et jamais en aliment. On lit dans Pline que le beurre était un mets délicat chez les nations barbares, et qui distinguait les riches des pauvres. » On utilise, en France, de nombreuses expressions dans lesquelles le mot « beurre » est associé à l'argent: « mettre du beurre dans les épinards », « vouloir le beurre et l'argent du beurre », « faire son beurre »…
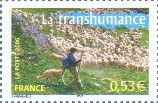
C'est bien une tradition ancestrale que de monter les troupeaux en estive, au printemps, par les routes et les sentiers de montagne et de les descendre à l'automne. Dès la fin du mois de mai, commence pour les moutons, la longue route vers les alpages. Chaque année, les troupeaux quittent la Provence, aujourd'hui en camion, autrefois à pied. Le voyage nécessitait plus de 10 jours de marche. La fête de la transhumance de Saint-Rémy de Provence, traditionnelle et émouvante, est sans aucun doute la fête la plus célèbre du Sud de la France. Elle fait revivre le souvenir de ce départ à pied vers les alpages.

L'hortillonnage est, avant tout, une technique de culture maraîchère d'une qualité exceptionnelle et pratiquée depuis le Moyen-âge dans la vallée de la Somme, sur des zones de cultures séparées par des petits canaux, alimentés par la Somme et l'Avre, ou circulent des bateaux à fond plat. Ces jardins ou « hortillons » ont été longtemps la seule source d'approvisionnement en légumes et en fruits de la région. Ils ont donné naissance à des records : un navet de 8 kg, un chou de 30 ! Ils restent des lieux d'agréments spécifiques des environs d'Amiens.
| Reproduction interdite © La Poste & Timbres Magazine 2006 |