Chacun des dix timbres du nouveau bloc de la France à vivre nous offre une halte célébrant un produit dont la notoriété s'étend fort loin dans l'espace et le temps. Le béret, baptisé « basque » par Napoléon III, est pourtant né à Nay, petit coin du Béarn. La silencieuse charentaise créée au XVIIème siècle a aujourd'hui épousé la mode jusqu'à devenir « tendance ». Le savon de Marseille, avec le retour aux valeurs naturelles, a retrouvé sa renommée mondiale. La ville de Grasse, de haut lieu de tannerie et du commerce de fourrure, est devenue et demeure la capitale mondiale du Parfum. Aubusson, capitale de la tapisserie, dont les ateliers retrouvèrent avec Jean Lurçat une nouvelle vie. Sèvres, associé à la porcelaine de grand luxe, a participé et continue de participer à la vie artistique de chaque époque. Les légendaires Géants du Nord ont fait leur entrée au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Le « bouchon » lyonnais au décor de taverne est aujourd'hui protégé par un label. Les marchés de Noël évoquent la magie de la fête toute proche. Le melon, roi de la famille des Cucurbitacées, souvent tout prêt au découpage grâce à ses côtes bien marquées, demeure le symbole de la convivialité.
   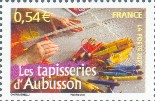  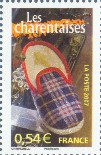 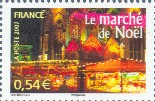 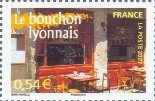   |

La région Nord Pas-de-Calais est le pays des fêtes et des Géants. Les Géants de Douai et de Cassel, gigantesques effigies de personnages légendaires, sont constitués d'une structure d'osier, surmontés d'une tête autrefois en bois, puis moulée en résine ou en carton-pâte. Ils tournent et dansent dans les rues en fête. Ils ont fait leur entrée au Patrimoine mondial de l'Unesco en novembre 2005. Plus précisément au patrimoine oral et immatériel de l'Unesco qui est, par définition « toutes les pratiques, représentations et expressions, les connaissances et savoir-faire que les communautés et les groupes reconnaissent comme partie intégrante de leur patrimoine culturel ». « Et ils tournent et ils dansent, les Géants, les Géants, de Douai à Cassel, de Cassel à Bailleul... » Ils sont honorés du titre de chefs d'œuvre avec mention spéciale aux fêtes de Douai et de Cassel, qualifiées de fêtes exemplaires pour leur ancienneté, leur excellente conception des Géants, leur caractère artistique. Cassel organise depuis 1901 le carnaval d'été, le lundi de Pâques. Un carnaval qui attire, chaque année, 15.000 visiteurs. Les deux Géants Papa Reuze et Maman Reuze, nés respectivement en 1827 et 1860, sont les plus vieux du Nord et ont été classés Monuments historiques en 2002. Pas moins de trois légendes racontent leur origine. L'association « les amis de Reuze Papa et Reuze Maman » fait vivre ces Géants : elle les habille, les coiffe. L'un porte un costume de légionnaire romain, l'autre, coiffée d'un diadème, est vêtue d'une robe rouge et d'un châle doré. En dehors du carnaval, on ne les voit pas. A Douai, les Géants sont les Gayants.

Le nom de « Sèvres » est associé à la porcelaine de grand luxe. Créée en 1740, à Vincennes, la Manufacture bénéficie du soutien de Madame de Pompadour, la favorite du roi Louis XV. En 1756, on l'installe à Sèvres. Elle y dispose d'un très bel ensemble immobilier. Les archives y sont conservées dans le département des collections de la Manufacture. La Manufacture nationale de Sèvres est un service à compétence nationale du ministère de la Culture et de la Communication. Depuis son origine, sa mission est la production des objets de céramique d'art selon des techniques artisanales : objets d'art rééditions de modèles anciens ou créations contemporaines d'après des objets soumis à un Conseil consultatif (institué en 1928, abandonné en 1991, réactivé en 2003) dont les membres assistent le directeur de la Manufacture dans le choix des artistes invités à travailler et dans le choix des projets nouveaux. « La recherche esthétique à Sèvres se doit de refléter le moment que l'on vit, et même à devancer le goût et la tendance... » Quelque 150 agents dont 120 céramistes, agents de l'État formés pendant trois ans au centre de formation interne de la Manufacture, sont repartis dans 27 ateliers. Ils exercent une trentaine de métiers différents et produisent, chaque année, quelques milliers de pièces. Un tiers de la production de la Manufacture est réservé aux grands corps de l'Etat : Palais de l'Élysée, Hôtel Matignon, Assemblée nationale, Sénat, Ambassades... L'autre partie est commercialisée dans ses deux galeries: à Sèvres et à Paris.

La Caisse des Monuments Historiques l'a classée Ville d'Art. Son architecture d'inspiration à la fois provençale et génoise fait d'elle un site médiéval au charme provençal. Perchée sur les contreforts des Alpes-de-Haute-Provence, Grasse ensoleillée est dotée de sources abondantes et d'un climat d'une douceur exceptionnelle convenant à l'exploitation de plantes fragiles venues de pays lointains. Les fleurs et quelques essences animales comme le musc et l'ambre sont à l'origine du parfum. Ce sont les fleurs qui ont fait de Grasse la capitale mondiale du Parfum, une industrie de prestige. Depuis des siècles, on y cultive rose, jasmin, lavande, iris et mimosa ainsi que les plantes aromatiques pour en tirer des essences. On y exploite les matières premières les plus recherchées au monde, comme la Rose « Centifolia », la tubéreuse et le Jasmin. Aujourd'hui encore, la plupart des grands Parfums sont créés à Grasse où se trouve le musée international de la Parfumerie.
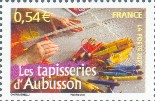
Aubusson, dans le département de la Creuse, possède un patrimoine architectural témoin de son riche passé et une devise qui fait rêver : « Inter spinas floret » (Elle fleurit au milieu des épines). Son nom rayonne dans le monde entier grâce au merveilleux savoir-faire de ses lissiers qui a transcendé les siècles et a fait de la tapisserie un moyen d'expression artistique contemporain. Capitale de la tapisserie depuis six siècles, Manufacture royale au XVIIème siècle, aujourd'hui encore Aubusson rassemble sur le même site toute la chaîne des métiers pour la réalisation d'une tapisserie. Les ateliers de tapisserie d'Aubusson font perdurer cet artisanat à travers des dizaines d'ateliers, des galeries, des musées et de nombreuses expositions, et Jean Lurçat, dans les années 30, en entraînant de nombreux artistes (Cocteau, Dali...) à s'exprimer à travers la laine, leur redonna une nouvelle vie. Rue Vieille, une bâtisse du XVIème siècle ayant appartenu à une famille de lissiers, abrite aujourd'hui la Maison du Tapissier où l'on peut voir la reconstitution d'un atelier d'autrefois. Quant au musée départemental de la Tapisserie d'Aubusson, il a été créé en 1981. Ses collections offrent un ensemble de tapisseries, de tapis, de cartons, de maquettes des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles (représentations historiques, mythologiques, bibliques, compositions bucoliques : « verdures », paysages et scènes de chasse). On y apprend toutes les étapes de la création d'une tapisserie.

Il est béarnais et on l'appelle « béret basque ». Probablement parce qu'il était porté par des joueurs de pelote basque de renom, et/ou que les touristes, découvrant la côte basque, l'achetaient en souvenir. Il est, pour les étrangers, l'image du Français armé de sa baguette de pain. Il est né à Nay (Pyrénées Atlantiques), un petit coin du Béarn entre Lourdes et Pau, où un musée raconte son histoire. À l'origine, les bergers le tricotaient eux-mêmes avec de longues aiguilles de buis, mais assez rapidement sa fabrication est devenue industrielle. Les étapes en sont nombreuses : tricotage, feutrage, teinture (marron à l'origine, il est devenu traditionnellement noir), mise en forme, séchage, grattage et rasage, enfin garnissage (doublure). Il doit être confortable, solide, imperméable, souple et léger ! L'authentique, le seul, le vrai est le béret basque de 120 grammes doublé et gainé de cuir. Il a fait un grand retour sur la scène internationale. Lors du 40ème anniversaire de l'insurrection cubaine, Fidel Castro a passé commande de 100.000 bérets. La photo de Che Guevara est remise à la mode et le béret basque est devenu « top tendance ».
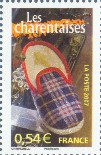
C'est en Charente que l'on fabrique ces sortes de pantoufles, ces chaussons à semelle de feutre et dessus de laine portés à l'intérieur de la maison ou glissés dans des sabots pour rendre ces derniers plus confortables. On les appelle « charentaises ». Elles furent créées au XVIIème siècle avec les restes du feutre utilisé pour la fabrication des uniformes des militaires des fortifications de la ville de Rochefort. Elles furent d'abord appelées les « silencieuses » car ceux qui les portaient se déplaçaient sans bruit dans les maisons. Au XXème siècle, un industriel de La Rochefoucauld inventa le collage du feutre et créa des pantoufles aux décorations de type écossais. Le succès mondial viendra avec James Rondinaud qui aura l'idée de les exporter aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, pour séduire les jeunes, la pantoufle charentaise grâce à des matières nobles (cuir, cachemire, satin), de nouvelles coupes, de nouvelles couleurs et de nouveaux motifs - tout en conservant sa semelle de feutre et sa fabrication au cœur du terroir de la mythique pantoufle - à rajeuni jusqu'a devenir « tendance ».
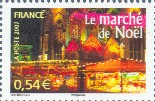
Les marchés de Noël se tiennent dans les dernières semaines de l'Avent. Leurs maisonnettes de bois, constructions éphémères, nous offrent tour ce qui peut contribuer à faire de Noël une superbe fête : décorations, guirlandes électriques, bougies, couronnes, calendriers, fleurs séchées... En Espagne, en Italie et dans le sud de la France, on y trouve les santons et tous les accessoires pour bâtir la crèche. On peut y acheter son sapin de Noël.
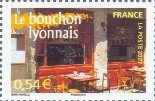
Lyon « qu'arrosent le Rhône, la Saône et le Beaujolais » est la capitale de la gastronomie, héritière des cuisiniers lucquois, florentins et génois attachés aux grandes maisons de banque, de commerce et de soie. Mais Lyon, ce n'est pas seulement les grandes tables, c'est aussi les « bouchons » qui servent des spécialités de cochonnailles (saucisson, cervelas, andouillette et rosette) arrosées de Beaujolais frais et parfumé. A l'origine, les « bouchons » étaient des auberges servant du vin, hors des repas et ils se distinguaient par un bouchon de paille accroché à leur enseigne. On y servait le « mâchon », un casse-croute à base de cochonnailles arrosé de bon vin. Aujourd'hui, véritable institution, le bouchon lyonnais au décor de taverne, à la cuisine simple généreuse et savoureuse, est protégé par un label.

Evoquant la simplicité, le naturel, la propreté, le Savon de Marseille traditionnel se présente sous la forme d'un gros cube de 600 g sur lequel sont gravés « 72% de matière grasse d'origine végétale » et le nom de la savonnerie. Il est certainement l'un des produits les plus connus au monde. Le terme de « Savon de Marseille » n'est pas une appellation d'origine contrôlée, mais correspond à une méthode de fabrication et à une composition. En 1688, un édit de Colbert réglementa sa fabrication avec « seulement des huiles d'olives pures, et sans mélange de graisse, sous peine de confiscation des marchandises ». Dans la région de Marseille, trois savonneries continuent à le fabriquer comme il y a deux siècles : la compagnie du Savon de Marseille, la Savonnerie du Sérail et le savonnier Marius Fabron à Salon de Provence. Sa fabrication artisanale prend trois semaines. Il mitonne à l'air libre dans des chaudrons avec des huiles végétales additionnées de soude. S'il est véritable, il est paille clair ou vert, et jamais parfumé, quand il est à l'ancienne... Après l'offensive des détergents de synthèse et avec le retour aux valeurs naturelles, il a retrouvé sa renommée mondiale.

Appartenant à la grande famille des Cucurbitacées, le melon (Cucumis melo) est une plante annuelle, rampante dont le fruit est une baie. Il est cultivé dans les régions chaudes et tempérées, dans le monde entier. Selon les variétés, sa forme, sa grosseur, la couleur de son écorce et de sa chair sont extrêmement variées. On déguste ce légume-fruit cru en hors d'œuvre ou en dessert. Les papes faisaient cultiver leurs melons par des moines à Cantalupo, d'où vient le nom de « cantaloup », variété cultivée en Comtat après le départ des papes. Cavaillon est actuellement le premier centre producteur français de melon, à la chair rouge orangée, si succulente. Il est très recherché par les confiseurs. Le « cantaloup » trouva la terre charentaise très à son goût. Ce melon à cotes remplit les étals en été, de même que celui de Tours et le melon maraîcher des environs de Paris. On trouve, aujourd'hui, d'excellents melons venant d'Afrique du Nord ainsi que de Guadeloupe où le melon charentais a émigré. Ces derniers ont l'avantage d'arriver sur nos tables avant la saison au moment où nous avons envie de fruits et légumes nouveaux. Quant au melon d'Espagne, mur à la fin de l'automne, il fait partie des treize desserts de Noël et est parfait pour la confiture.
| Reproduction interdite © Timbres magazine 2007 |