


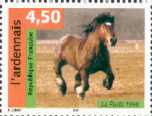
|
Nature de France Chevaux (1998).
|
|||
 |
 |
 |
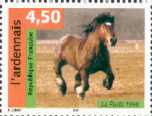 |
| Le Camargais | Le Trotteur | Le Pottok | L'Ardennais |
|
|
|||
| Le Camargais | |||
       
|
|||
|
Impossible d'imaginer la Camargue sans le Camarguais (appelé aussi Camargue). Vigoureux cheval à la robe toujours grise. Il est la monture traditionnelle des gardians, ces infatigables cavaliers qui veillent sur les troupeaux de taureaux élevés en liberté - avant de rejoindre les arènes ou les rues des villages pour les fêtes populaires. Agile, courageux, nullement effrayé par les bovins, le Camarguais travaille avec le taureau aussi naturellement que le chien de berger avec son troupeau de moutons. Quiconque a vu un jour galoper un troupeau de Camarguais dans l'immensité des marais, soulevant des gerbes d'écume, a gardé en mémoire cette image caractéristique de la Camargue. Ce "cheval de la mer" possède une exceptionnelle résistance, qu'il doit au milieu hostile dans lequel il vit en liberté depuis des siècles, évoluant dans des terrains marécageux aux eaux saumâtres, se nourrissant de maigres plantes aquatiques. Bien que sauvage par nature, il se révèle après dressage un bon cheval de selle, au pied sûr. Le développement du tourisme lui a permis ainsi de connaître une nouvelle carrière de cheval de randonnée, son endurance et sa sobriété étant particulièrement adaptées aux sites sauvages du delta du Rhône. Sa race, officiellement reconnue en 1968, est aujourd'hui protégée. Le Camarguais mesure généralement 1,40 m au garrot. Sa tête est souvent lourde et grossière, son encolure, sa croupe et ses membres sont courts. Ses sabots sont si durs qu'il est rarement ferré. Sa queue et sa crinière sont longues et bien fournies. Le Camarguais se développe lentement - il n'atteint l'âge adulte qu'entre 5 et 7 ans - et jouit d'une longévité exceptionnelle, qui dépasse fréquemment les 25 ans. Ses allures sont caractéristiques : le pas est relevé, avec de longues foulées ; le trot court et surhaussé ; le galop remarquablement ample. Autre caractéristique, due cette fois à la main de l'homme : il porte généralement sur la fesse gauche, imprimée au fur, la marque de la manade (le troupeau) ) à laquelle il appartient. |
|||
|
| Le Trotteur | |||
       
|
|||
|
Difficile de confondre le Trotteur français avec l'imposant Ardennais ou les solides Camarguais et Pottok. Car ce grand cheval aux membres déliés et à l'allure altière, cousin fort éloigné des chevaux de trait et autres races rustiques, fait partie de ces lignées de courses soigneusement affinées au fil des décennies - ces races de champions dont les ancêtres portent des noms prestigieux associés aux trophées qu'ils ont remporté. Les origines du Trotteur français se confondent avec celles du Normand, d'où son autre nom de Trotteur normand. La sélection de la race remonte précisément à 1836, année où se disputèrent sur l'hippodrome de Cherbourg les premières épreuves officielles de trotteurs. De cette époque date l'influence de demi-sang et de pur-sang anglais, qui ont contribué à la formation de la race. Egalement déterminants dans les origines du Trotteur français, les sujets Norfolk lui ont transmis son aptitude au trot. Dans la longue généalogie de ce grand professionnel des courses de trot attelé et monté, caractérisé par son aptitude à la vitesse et au fond, quelques "chefs de lignée" sont entrés dans l'histoire de la race, tels Conquérant, Lavaret, Normand, Niger et Phaéton, dont descendaient au siècle dernier la plupart des Trotteurs français, et, plus récemment, Minou du Donjon, qui décrocha en 1985 le record de vitesse de la race. Haut de 1,55 m à 1,65 m au garrot, doué d'un caractère tranquille mais énergique, le Trotteur français est un cheval de structure robuste et imposante, de type longiligne. La tête est belle et bien attachée, le profil rectiligne, le front large, les oreilles longues et écartées, l'œil vif et les naseaux larges. L'encolure est musclée, le garrot saillant et sec, le dos et les reins bien développée, la croupe longue, large et légèrement oblique, les membres fins mais musclés et bien conformés, le pied parfois délicat et plutôt adapté aux terrains légers. Quant à la robe, elle peut être de type bai sombre, noir, alezan, alezan brûlé, rarement gris. |
|||
|
| Le Pottok | |||
       
|
|||
|
On le rencontre encore en liberté dans les collines du Pays basque. Le Pottok (prononcez "potiok"), dont le nom signifie "de petite stature" en basque, se confond avec l'histoire de la région. Il était jusqu'au milieu de ce siècle le plus fidèle compagnon des contrebandiers, qui le chargeaient de marchandises pour franchir les cols qui séparent la France de l'Espagne. La contrebande étant tombée en désuétude, il est aujourd'hui revenu sur les chemins de la légalité et sert surtout de poney de selle aux enfants. S'il a élu principalement domicile au Pays basque français et espagnol, au point de faire partie intégrante du patrimoine culturel, ses origines renvoient à des horizons plus vastes. Le Pottok, en effet, descend probablement du cheval de Solutré et aurait, dit la légende, servi de monture aux Wisigoths, Mâtiné de sang oriental, il aurait également participé à la formation du Tarbais. Ce rustique animal proche des chevaux "archaïques" multiplie les qualités. Apte aussi bien à la selle qu'aux travaux agricoles et au trait léger, il est également bon sauteur. Robuste, prolifique, il possède un caractère à la fois tranquille et énergique. D'autant plus tranquille que le Pottok, décrit naguère comme un poney sauvage, a fait l'objet ces dernières décennies de travaux de sélection de la race. Haut de 1,15 m à 1,50 m au garrot selon des types, le Pottok possède un profil droit avec une légère concavité entre les yeux, une encolure courte, des épaules droites, une croupe arrondie, des membres secs et résistants ainsi qu'un sabot petit et bien fait. Sa queue est longue et abondante, sa crinière hirsute. Son œil est grand et expressif, ses naseaux larges. Quand il se nourrit de plantes épineuses, sa lèvre arbore une moustache de protection, qui disparaît quand il diversifie son alimentation. Ses robes varient selon les types. Le Pottok "standard" ou "double" est le plus souvent alezan, bai brun et bai. Le pottok "pie" peut être noir et blanc mais aussi fauve, blanc et noir, ou fauve et blanc. |
|||
|
| L'Ardennais | |||
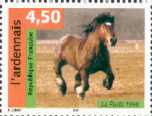 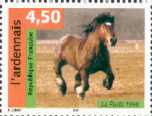 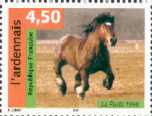 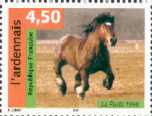 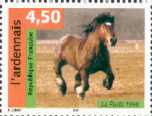 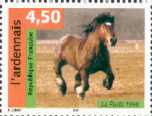 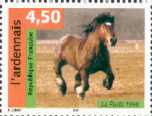 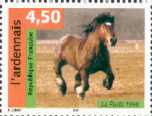
|
|||
|
L'Ardennais est considéré comme le plus ancien des chevaux de trait lourd européens. Originaire, comme son nom l'indique, du massif des Ardennes, il descendrait du cheval préhistorique de Solutré. Il pourrait également compter comme autre prestigieux ancêtre le cheval de trait décrit par Jules César dans ses Commentaires sur la guerre des Gaules, qui mesurait alors 1,45 m au garrot. Jusqu'au XIXème siècle, l'Ardennais servit surtout pour la selle et le trait moyen. Il était ainsi fréquemment utilisé comme cheval de diligence. L'apport de sang oriental, sous le premier Empire, lui a permis de développer des qualités de fond et de résistance, au point qu'il s'illustra pendant la campagne de Russie, où il fut le seul cheval à résister à l'hiver moscovite, permettant ainsi de rapporter une partie du train de l'Empereur lors de la retraite. Les croisements opérés au début du siècle dernier ont donné naissance à trois types : l'Ardennais proprement dit, d'une hauteur au garrot de 1,50 m à 1,60 m, aujourd'hui en déclin ; l'Auxois, plus massif, en voie de disparition ; le Trait Nord¸ le plus grand des trois. Plus ramassé et plus trapu que les autres chevaux lourds, l'Ardennais est aussi puissant que docile. Particulièrement coopératif, il pourrait être aisément conduit par un enfant. Solidement campé sur des membres courts et très musclés, recouverts de crins épais jusqu'aux genoux et aux jarrets, on le dit "construit comme un tracteur"- constitution qui lui valut notamment d'être réquisitionné pendant la Première Guerre mondiale pour tirer les canons et chariots de munitions. Sa tête est caractérisée par un front large et de petites oreilles dressées, inhabituelles chez les chevaux de trait. L'Ardennais est le plus souvent rouan avec, en général, une crinière blonde, rouan vineux, bai ou aubère. On le rencontre également avec des robes grises et alezanes, mais jamais noires. |
|||
|