
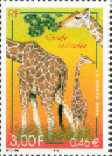
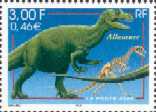

Sardanapale
réticulée
lutea
|
Regards sur la nature (2000).
|
|||
 |
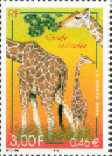 |
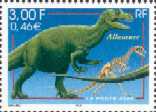 |
 |
|
Papillon Sardanapale |
Girafe réticulée |
Allosaure |
Tulipa lutea |
|
|
|||
| Papillon Sardanapale | |||
       
|
|||
|
Cinquante millions d'insectes : tel est le nombre de spécimens que le Muséum national d'Histoire naturelle conserve dans ses collections. Ce patrimoine national figure parmi les trois plus importants au monde. Depuis Lamarck, premier responsable en 1793, de la collection d'insectes, mais surtout depuis Latreille, en 1830, fondateur de l'entomologie moderne, le Muséum n'a cessé d'enrichir ses collections. Le laboratoire d'entomologie en assure la conservation, mais aussi la gestion scientifique. En effet, il n'en est pas seulement le gardien ; ses collections constituent une source fondamentale pour la connaissance de la multiplicité des espèces. Les chercheurs qui y sont attachés poursuivent, entre autres objets d'investigation, l'étude des phénomènes de l'évolution et de la formation des espèces qui se sont produits depuis les temps géologiques. Il appartient au Muséum national d'Histoire naturelle de faire connaître au public le monde des insectes, lesquels ne jouissent pas d'une grande notoriété. La philatélie lui offre aujourd'hui l'occasion de mettre en valeur une de ses pièces de collection. Agrias sardanapalus, qui est représenté sur le timbre-poste, appartient, comme tous les papillons, à l'ordre des Lépidoptères. Il fait partie du groupe des Rhopalocères, ou "papillons de jour", qui se représentent qu'un dixième de tous les Lépidoptères, les autres étant souvent très petits (les mites) ou nocturnes. C'est sous les latitudes tropicales, en Amazonie, que vit le sardanapale. Sa chenille, de couleur terne, porte une paire de cornes sur la tête et deux longues queues. A l'état d'adulte, les papillons ne consomment que des substances liquides : le nectar des fleurs reste leur principal aliment. Cet insecte se caractérise, comme tous les papillons dits "de jour", par des couleurs souvent vives et des antennes se terminant en massue. Au repos, les ailes sont redressées au-dessus du corps. Comme les autres espèces de la grande famille des Nymphalidae plus de 5.000 espèces), le sardanapale ne marche que sur quatre pattes (les insectes en ont habituellement six), car les pattes antérieures sont atrophiées. Chez le mâle, celles-ci sont garnies de longues soies denses, comme un pinceau. Certaines espèces sud-américaines, très riches en couleurs, sont vivement recherchées par les collectionneurs. Voilà l'occasion pour les lépidoptérophiles-philatélistes, de faire d'une pièce deux coups. |
|||
|
| Girafe réticulée | |||
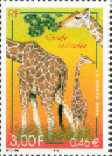 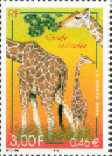 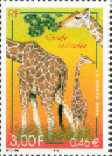 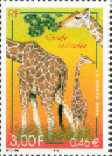 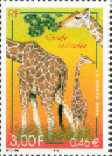 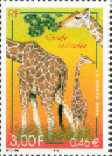 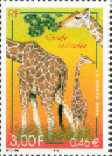 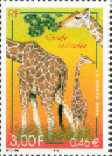
|
|||
|
Le nombre de spécimens conservés à la zoothèque du Muséum national d'Histoire naturelle donne le vertige : 30.000 oiseaux, 30.000 mammifères, 500.000 reptiles et amphibiens, 500.000 poissons, plus de 5 millions d'invertébrés. La plupart d'entre eux datent du XIXème siècle. Ils sont essentiellement voués à l'étude scientifique. Une infime partie de la collection seulement est exposée au public dans ce vaste bâtiment connu aujourd'hui sous le nom de Grande Galerie de l'Evolution. Le vieil édifice, conçu en 1884, avait dû fermer ses portes en 1965 faute de crédits et d'entretien des collections. Quinze ans plus tard, on entreprit la construction d'une zoothèque souterraine et un concours fut ouvert pour la rénovation de la Grande Galerie. Dans l'esprit de l'architecte lauréat, il importait de respecter l'architecture et la mémoire du lieu. Après plusieurs années de travaux, la Grande Galerie de l'Évolution est inaugurée en 1994. Dans ce vaisseau long de 55 mètres, la nef centrale présente la diversité du vivant en même temps qu'elle souligne son unité. Haute de 20 mètres, cette arche de Noé abrite quelques-uns des animaux les plus grands de la Création, telle cette girafe réticulée représentée sur le timbre-poste. Giraffa camelopardalis vit en Afrique, dans une zone qui s'étend du Sud du Sahara aux abords du Cap. Giraffa camelopardalis reticulata, la girafe réticulée, vit quant à elle, en Somalie et au Kenya. La girafe peut atteindre une taille de 5,80 m au sommet de la tête et peser jusqu'à 2 tonnes. Deux à cinq cornes recouvertes de peau, oreilles étroites et pointues, grand yeux et lèvres allongées, museau : tels sont les caractères morphologiques de la tête. La girafe est douée d'une grande acuité visuelle. Elle est capable de reconnaître un congénère à une distance d'un kilomètre. Les girafes viventen petits groupes et forment parfois des troupeaux de cinquante individus. Elles ont un caractère sociable car elles cohabitent sans difficulté avec les autres animaux de la steppe. Ces derniers trouvent en leur compagnie une certaine sécurité. Dominant l'horizon, les girafes, véritables "tours d'observation", jouent le rôle de guetteurs. Elles n'ont rient à craindre des lions dont elles peuvent briser le crâne d'un coup de sabot des pattes antérieures. Leurs principaux prédateurs sont les hommes. Les girafes de Nubie et du Cap ont été en grande partie exterminées. Les autres sous-espèces vivent aujourd'hui en effectifs très réduits. |
|||
|
| Allosaure | |||
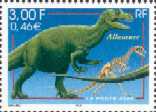 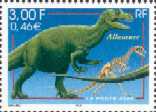 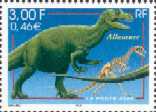 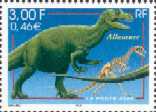 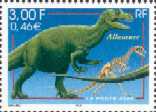 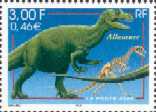 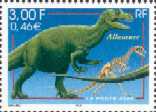 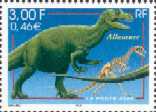
|
|||
|
"Mastodontes à cornes, bœufs-rhinocéros, hippopotames crochus, sangliers dirigeables, dragons à pieds d'éléphants ou phoques sur châssis de dromadaires...". Ce n'est pas un inventaire à la Prévert mais la vision de l'écrivain Léon-Paul Fargue lorsqu'il découvrit en 1939 la galerie de paléontologie du Muséum national d'Histoire naturelle. Depuis Cuvier, fondateur de la science qui étudie les espèces disparues et l'ouverture au public, en 1898, des galeries d'anatomie comparée et de paléontologie, le Muséum a considérablement enrichi ses collections. Toutes les acquisitions notables ne remontent pas aussi loin. De la première expédition française au Spitzberg en 1969, l'équipe du Muséum, associée au CNRS, rapporta vingt-cinq tonnes de matériel. Plus près de nous, le Muséum acquiert en 1985 les fossiles trouvés dans le camp militaire de Canjuers (Var). On y dégagea en particulier le squelette d'un petit dinosaure carnivore, cousin germain de l'archéopréryx. Aujourd'hui, le "temple de l'ostéologie" regroupe près d'un millier de squelettes actuels et fossiles reconstitués et montés. Cet ensemble unique au monde est présenté selon un ordre chronologique. Les squelettes sont disposés des plus anciens aux plus récents. A l'entrée de la galerie de paléontologie, le visiteur est accueilli par le moulage du squelette de Diplodocus carnegii offert à la France an 1908 par l'Américain Andrew Carnegie. Parmi les pièces remarquables de la galerie se trouvent le mosasaure de Maastricht et le Megatherium, tous deux découverts par Cuvier, ainsi qu'une collection très complète de mastodontes et d'éléphants fossiles avec le squelette du célèbre mammouth dont le corps congelé dans les glaces de Sibérie a été découvert en 1905. On y voit également l'impressionnant allosaure, représenté sur le timbre-poste. Allosaurus vivait en Amérique du Nord, il y a environ 150 millions d'années. Mesurant jusqu'à 12 mètres de long, ce carnassier bipède pouvait s'attaquer aux grands dinosaures herbivores comme le diplodocus. L'animal avait une grosse tête et un cou puissant. Il était doté de robustes mâchoires garnies de plus de 70 dents acérées et coupantes qui lui servaient à tuer et déchiqueter ses proies. Le corps fortement charpenté reposait sur des membres postérieurs robustes et se terminait par une queue massive. Les membres antérieurs, plus petits, se prolongeaient par trois doigts munis de griffes crochues. parmi les dinosaures, il est un des prédateurs les plus grands et les plus terrifiants de son temps. |
|||
|
| Tulipa lutea | |||
       
|
|||
|
Riche de plus de 8 millions de spécimens, l'herbier du Muséum national d'Histoire naturelle est le plus important au monde tant par la diversité des espèces qui y sont conservées que par le volume. Presque toutes les espèces de plantes supérieures et fougères recensées sur la planète y sont représentées. Pressées, séchées, et montées sur un carton, elles fournissent aux chercheurs une matière à étude sans équivalent. Chaque année, plusieurs centaines d'entre eux, qu'ils soient botanistes, écologistes, pharmaciens ou historiens, se penchent sur ce patrimoine végétal auquel il faut naturellement ajouter les collections vivantes de plantes soigneusement entretenues dans les jardins et les serres. Le Muséum conserve également des pièces historiques comme les champignons de cire de Pinson acquis en 1825 ou les modèles de fruits tropicaux sculptés par Louis-Robillard d'Argentelle et achetés en 1889. Il est aussi une collection dont le grand public ignore l'existence et qui sert autant l'art que la science : les vélins. On désigne sous le nom de vélin la peau de veau mort-né. Bien préparé, le vélin offrait au XVIIème siècle un support idéal et luxueux pour la représentation du monde végétal et animal. Il avait la particularité d'être parfaitement blanc, fin, transparent, souple et léger. Les premiers vélins furent commandés par le frère de Louis XIII, Gaston d'Orléans, lequel confia à Nicolas Robert, vers 1630, le soin de représenter, sur ce matériau noble, des plantes rares rapportées de pays lointains et cultivées dans les jardins du château de Blois. A la mort de Louis XIII, Louis XIV hérita de la collection et nomma Nicolas Robert "peintre ordinaire du roi pour la miniature". Il prenait ses modèles au Jardin du Roi. Il laissa à sa mort, en 1685, 727 vélins dont 457 consacrés à la botanique. Ses successeurs accrurent la collection. On comptait en 1706 déjà 2.000 pièces, mais la plupart n'étaient pas signées. Le vélin de tulipe représenté sur le timbre-poste fait partie de ces œuvres non attribuées. En 1793, les vélins, jusqu'alors déposés à la Bibliothèque royale, rejoignirent la nouvelle Bibliothèque du Muséum. Commença alors le règne de Pierre-Joseph Redouté, le "Raphaël des fleurs", qui signa 556 vélins. Par la suite, la peinture sur vélin connut quelques éclipses. La collection compte aujourd'hui 7.000 pièces. Le Muséum, désireux de poursuivre son enrichissement et de maintenir la tradition, continue aujourd'hui de passer des commandes à des artistes peintres. |
|||
|